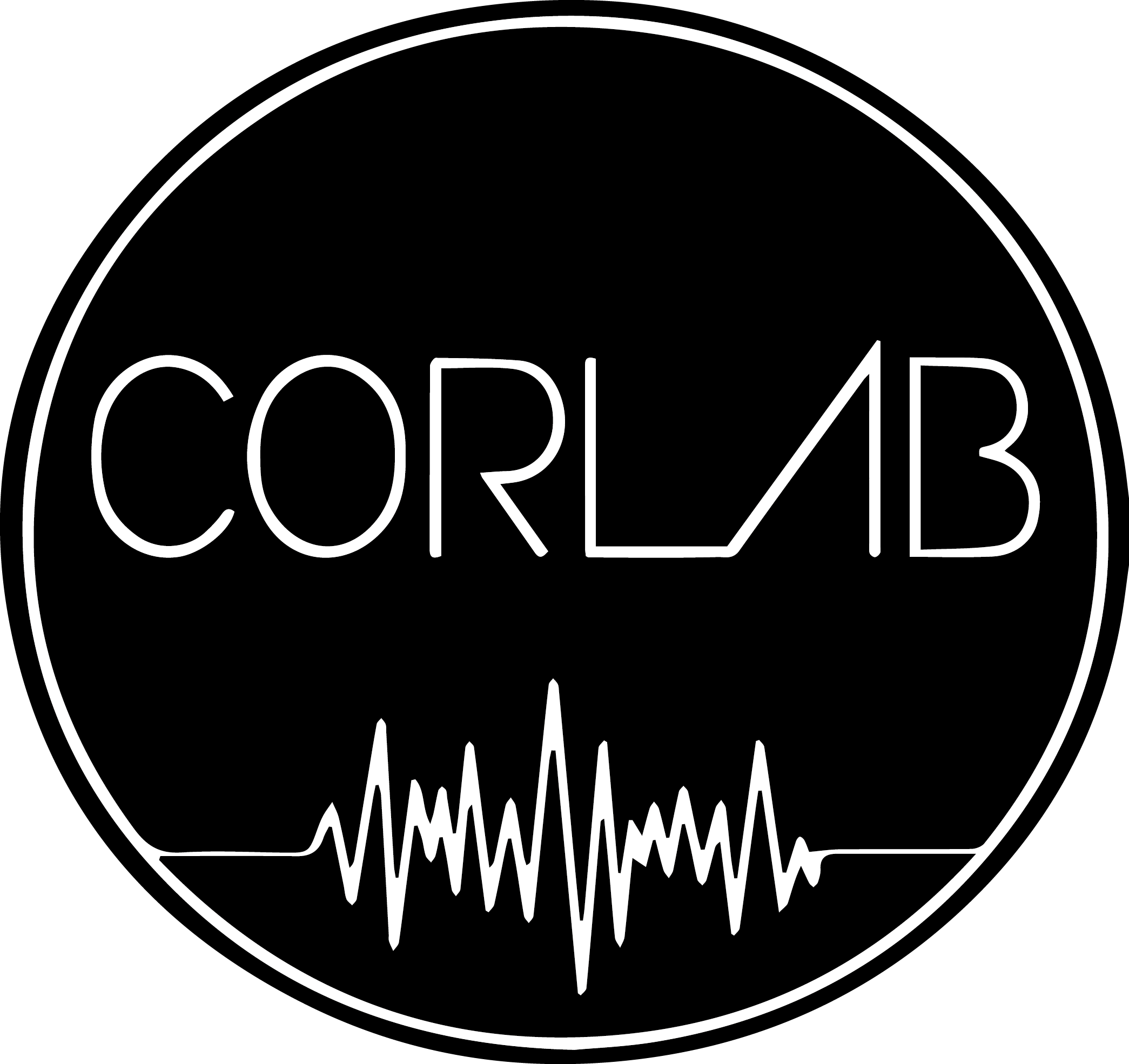MÉMOIRES DE VI(LL)ES
Châteaugiron - Radio Laser
« Mémoires de vi(ll)es » est un projet de collectages radiophonique porté par l’association Petites Cités de Caractère® de Bretagne et la Coordination des Radios Locales et Associatives de Bretagne (CORLAB).
Cette seconde saison s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet « L’Été culturel » de la DRAC Bretagne, visant à proposer des animations durant la période estivale aux publics qui ne partent pas en vacances.
Photos : Sarah Chajari – L’Atelier du Canal
LES HABITANT·ES

Monique Coquantif

Victor Dauvier

Marie-Thérèse Poulain

Marie-Angèle Trovallet

Jean-Claude Beline

Jean-Paul Bourdon

Jean Crocq

Victor Daniel

Marie Daniel
LA RADIO

Radio Laser
Pierre-Louis Dupret
J’ai eu l’honneur de participer au projet « Mémoires de vi(ll)es » dans la charmante commune de Châteaugiron. Cette initiative m’a conduit à la rencontre des résidents de l’EHPAD Les Jardins du Castel. Ensemble, nous avons partagé des moments d’une grande richesse humaine, où ils ont confié des souvenirs marquants de leurs vies et de leurs métiers. Le projet s’est élargi à l’histoire collective de Châteaugiron. Grâce à la participation des habitants de la commune, nous avons pu recueillir de s fragments d’un passé vibrant, tissés de souvenirs et d’anecdotes. Ces histoires, désormais préservées, continueront à témoigner de la richesse humaine et culturelle de Châteaugiron pour les générations à venir. Ce projet a également été une formidable source d’enrichissement pour Radio Laser. Il a permis de tisser des liens uniques avec les habitants et de porter à l’antenne des témoignages authentiques et émouvants, véritables reflets de la mémoire collective. Ces récits, empreints de sincérité, renforcent notre mission de radio associative : être une radio proche des gens, engagée dans la valorisation des voix et des histoires locales.
LES ÉPISODES
L'école
L’école privée Saint-Pierre de Châteaugiron, située à deux pas du château, a marqué des générations d’élèves par son approche rigoureuse et parfois sévère. Elle attirait des élèves de tout le département, composée de quatre classes allant jusqu’au certificat d’études. Sous l’abbé Dogan et de Monsieur Chenedet, la discipline a laissé une empreinte indélébile auprès des anciens élèves qui en avaient la trouille, avec des règles précises et des sévices corporels parfois sévères.
Victor se souvient de la proximité entre l’école et les familles, les instituteurs se déplaçant souvent chez les élèves pour discuter avec les parents lors de « visites de courtoisie ». Les enfants se cachaient et n’ont jamais vraiment su ce qui se disait ! L’école à l’époque était empreinte de valeurs catholiques, elle imposait une présence à la messe et des visites fréquentes de prêtres et religieuses. Affublés de blouses différentes chaque semaine, afin que l’enseignant puisse vérifier leur lavage, les élèves veillaient au nettoyage des tables souvent salies à l’encre et à l’alimentation en bois du poêle. La cour de récréation était un terrain d’aventures pour des jeux variés (montée à la corde, billes, canettes, balle aux prisonniers, marelle…) et en hiver, des glissades mémorables. Le midi, c’étaient les Bonnes Sœurs et Madame Chenedet qui faisaient la cuisine tandis que les parents agriculteurs fournissaient des produits de la ferme. En 1954, Pierre Mendès instaura le verre de lait quotidien pour les écoliers afin de lutter contre la dénutrition (en période d’après-guerre) et l’alcoolisme… car à l’époque, il était courant de servir du cidre aux enfants !
« On nettoyait les tables à l’encre et à l’encaustique. Ça sentait un drôle de mélange en entrant dans la classe. »
« Je tournais la baratte avant d’aller à l’école le matin, et faisais l’écrémage du lait le soir. »
« C’était une enfance heureuse malgré la sévérité. »
« Le respect autrefois, c’était sacré ! »
Le café Pôle Emploi
Dans les années 50, Châteaugiron ne comptait pas moins de 25 cafés et bistrots, véritables lieux de vie où la communauté se rassemblait notamment après la messe, les hommes d’un côté et les femmes de l’autre. Victor nous emmène notamment au cœur du café Pirois, le plus important de l’époque, qui se transformait en centre d’embauche agricole lors de la Saint-Pierre et de la Saint-Jean.
Les employeurs et les ouvriers venant des alentours (Domloup, Nouvoitou, Noyal-sur-Vilaine…), s’y retrouvaient pour proposer ou dénicher des contrats en tant qu’employés agricoles. Il existait quatre types de contrats, du chartrier (amené à conduire les chars pour les labours) à l’ouvrier de bras (pour les tâches lourdes), en passant par la servante (essentielle pour les tâches domestiques en maison et avec les animaux) et le jeune « patou » qui veillait sur les vaches dans les champs (non clôturés à l’époque). Si l’affaire était conclue, l’ouvrier avait un denier qu’il gardait pendant toute la période d’embauche. Il était rendu en cas de rupture du contrat si les conditions ne lui plaisaient pas, même si globalement à l’époque, personne ne protestait !
Les fêtes
En début d’épisode, Jean-Claude retrace l’histoire de Châteaugiron, une ville qui doit son caractère au puissant château dont les hautes tours signalent le cœur de ville, et au commerce des toiles en chanvre, « les noyales », aux XVIIIe et XIXe siècles. Le château a connu bien des usages au siècle dernier, abritant tour à tour le Centre féminin d’apprentissage, diverses entreprises de lingerie et de production de lait, et aujourd’hui la mairie. Sa chapelle, successivement salle de patronage et cinéma (entre 1927 et 1978) est aujourd’hui le centre d’art les 3 CHA.
Les habitants nous racontent aussi que le château fut le théâtre de bals populaires et spectacles organisés par la ville, avec des musiciens célèbres (Yvette Horner, Paul Renimel) sans oublier la fête des célibataires et la kermesse. Sa popularité était à son apogée dans les années 1985-1990 avec la création d’un spectacle Son et Lumière qui retraçait l’histoire de la ville. Ecrit par l’historien Père Royer, ce spectacle attirait jusqu’à 900 spectateurs venus admirer plus de 200 acteurs bénévoles sur scène. La popularité de ces fêtes, malgré la concurrence du Puy du Fou, témoigne d’une époque où chacun s’impliquait activement.
L’organisation d’un critérium participa aussi à cette renommée avec la venue de nombreuses vedettes du cyclisme à cet évènement, qui se positionnait comme le premier critérium après le Tour de France. Il y avait aussi la Fête-Dieu chaque année, à l’occasion de laquelle les rues étaient décorées avec des parterres de fleurs et de la sciure de toutes les couleurs. Enfin, le 14 juillet, toute la population se rassemblait autour du cercle laïque et de la fanfare au pont de Seiche et place des Gâtes pour un moment festif.
« Je ne veux pas me flatter, mais j’étais le premier à rentrer en scène sur l’histoire de Châteaugiron. »
« Je travaillais à la buvette. Certains soirs, des cars entiers arrivaient de Rennes et il y a eu des bagarres ! »
Le train
Les habitants se souviennent avec nostalgie du train à vapeur qui reliait Rennes à La Guerche-de-Bretagne entre 1898 et 1948, en passant par Châteaugiron dont la gare était située au niveau de l’actuel parking des Douves. Ce train, circulant à 25 km/h, était une véritable prouesse, fonctionnant au charbon et pouvant peser entre 16 et 60 tonnes selon son chargement. Outre les marchandises, il transportait des voyageurs, notamment les élèves se rendant au lycée guerchais. Les jours de marché et pendant la foire de Rennes, le train était bondé. Le reste du temps, les habitants de Châteaugiron vivant majoritairement en autarcie et avaient peu besoin de se déplacer jusqu’à Rennes. Marquant tragiquement les mémoires, le train fut bombardé le 10 juin 1944 par les alliés lors de son l’arrêt à Domloup et le conducteur fut tué. Cette ligne emblématique a disparu avec le développement des autocars, mais les cartes postales sont nombreuses à la figurer.
« Il lui arrivait d’avoir des problèmes en fonction du nombre de voyageurs ou du matériel transporté et de ne plus pouvoir monter les côtes. On demandait aux gens de descendre sur une centaine de mètres pour que le train reprenne un peu de vitesse. »
« Après le certificat, les jeunes adoraient aller à Rennes, en stop ou à vélo. Pour faire un tour des disquaires, des Nouvelles Galeries Lafayette et nager à la piscine Saint-Georges ! »
La Libération
C’est avec émotion que les habitants revivent l’arrivée des troupes allemandes du 17 juin 1940, depuis la route de Janzé. Présents dans toute la ville, les soldats en jeeps et chars s’imposaient chez les particuliers pour y loger. Chaque soir, après leur ronde pour faire respecter le couvre-feu, ils se retrouvaient au café de la Briqueterie pour dîner. Les soldats n’hésitaient pas à se servir directement chez les familles en œufs, poules ou beurre, laissant les habitants parfois démunis. Dès 1939, les tickets de rationnement devinrent essentiels, régissant l’accès aux produits du quotidien comme le tabac et les bougies, et restèrent en vigueur pendant dix ans, même après l’Occupation. Malgré la lourdeur de ce quotidien, une résistance locale s’organisait, s’efforçant de saboter les projets allemands, au péril parfois de lourdes conséquences.
« [Les Allemands] se sont aperçus qu’il y avait un drapeau bleu-blanc-rouge sur le château. Ils ont fait toute une polémique et il a fallu absolument trouver un couvreur qui puisse venir pour démonter le drapeau au-dessus du donjon. »
« Tous les Français avaient peur des Allemands. »
Marie-Thérèse et son café Poulain
A Châteaugiron, le café Poulain était bien plus qu’un simple commerce : c’était un lieu de vie et de rencontres pour les habitants. Marie-Thérèse servait une clientèle masculine d’habitués, venu boire un verre, écouter la radio ou jouer aux cartes et aux palets. Les ouvriers aimaient y prendre leur repas, partageant parfois leurs frites avec ses petits-enfants. Le dimanche était le seul jour où les femmes franchissaient les portes du café, après la messe, pour demander « un petit quelque chose de doux ». Le café offrait un large choix de boissons : cidre des fermiers locaux, vin rouge, vin blanc, bière, café bien sûr, et enfin du muscadet que Marie-Thérèse allait chercher elle-même chez un producteur nantais ! Le café Poulain proposait aussi quelques services de dépannage, comme la vente de billets de bus et de tabac. Connue de tous, Marie-Thérèse appréciait voir du monde et garde de nombreux souvenirs de cette époque, bien que la disparition progressive des anciens lui pince le cœur.
« Tout le monde allait là, c’était bien placé au bord de l’église. Il y avait une bonne clientèle et Madame Poulain était très gentille. »
« On avait une bonne clientèle d’amis et de copains. »
Victor Dauvier, maraîcher et ouvrier du bâtiment
Victor Dauvier, grand joueur de palet (qu’il pratique toujours sur le terrain de l’EHPAD !) a connu une vie professionnelle riche en rebondissements. Maraîcher pendant sept ans, il a cultivé avec passion tomates, courgettes et concombres dans ses serres situées sur l’actuel boulevard Albert 1er de Châteaugiron. Mais aussi plaisant soit-il, ce métier ne suffisait pas à joindre les deux bouts. C’est pourquoi Victor s’est résolu à changer de voie vers les métiers du bâtiment, un secteur en plein essor à l’époque. Victor s’est investi pleinement dans ce nouveau métier, trouvant une certaine fierté à bâtir. Il se souvient particulièrement des chantiers de garages, un travail d’équipe exigeant, mais gratifiant. Aujourd’hui, Victor parle des mutations du secteur et regrette le manque d’engouement des jeunes pour ces professions, pourtant essentielles au développement de la ville. Son parcours reflète l’évolution morphologique et sociétale de Châteaugiron, passant d’une économie rurale à une économie plus urbaine.
« C’est une petite commune qui a bien grandi. »
Suzanne Pottier, agricultrice
A entendre Suzanne, les journées étaient longues et laborieuses, le matériel agricole rudimentaire et les tâches nombreuses, du soin des animaux aux travaux des champs. Suzanne se souvient des heures passées à traire les 30 vaches de la ferme, d’abord à la main puis à l’aide de la trayeuse mécanique, une innovation qui a révolutionné son quotidien. Malgré les difficultés, Suzanne était fière de son métier. Chaque récolte, chaque animal soigné était une victoire. Consciente des changements qui ont amélioré le monde agricole, en termes de matériel notamment, Suzanne s’inquiète pourtant des difficultés rencontrées par les jeunes agriculteurs aujourd’hui, confrontés à la pression financière et aux aléas climatiques. Son témoignage nous rappelle les sacrifices et la passion qui ont façonné la vie des agriculteurs d’autrefois, et nous invite à réfléchir aux défis de ce métier si essentiel.
« On vivait mieux notre métier qu’aujourd’hui. Aujourd’hui, ils ont moins de mal que nous bien sûr, mais est-ce que ça paye ? »
Armand Lefaix, couvreur
Armand Lefaix, originaire de Corps-Nuds à 12 km de Châteaugiron, a passé plus de 40 ans à exercer le métier exigeant de couvreur dans la Petite Cité de Caractère®. Formé sur le tas, il a appris à maîtriser les risques du métier, car monter sur les toits, parfois très hauts comme les clochers d’église, exigeait courage et sang-froid ! Il fallait affronter la pluie, le vent, le risque de glisser, sans jamais perdre sa concentration, et travailler du lundi au samedi. Armand se souvient avec fierté de son travail, perché entre ciel et terre sur les toits des maisons de Châteaugiron et des environs. Il a contribué à embellir la ville, posant avec soin ardoises et fibrociment. Son témoignage nous rappelle que derrière chaque toiture se cache le savoir-faire d’artisans passionnés comme Armand, qui ont donné vie au paysage architectural de la commune.
« Je me souviens être monté haut, autour des clochers de l’église, pour nettoyer les gouttières et tout ça. »
« On travaillait du lundi au samedi, on n’avait pas des jours de repos comme maintenant. »