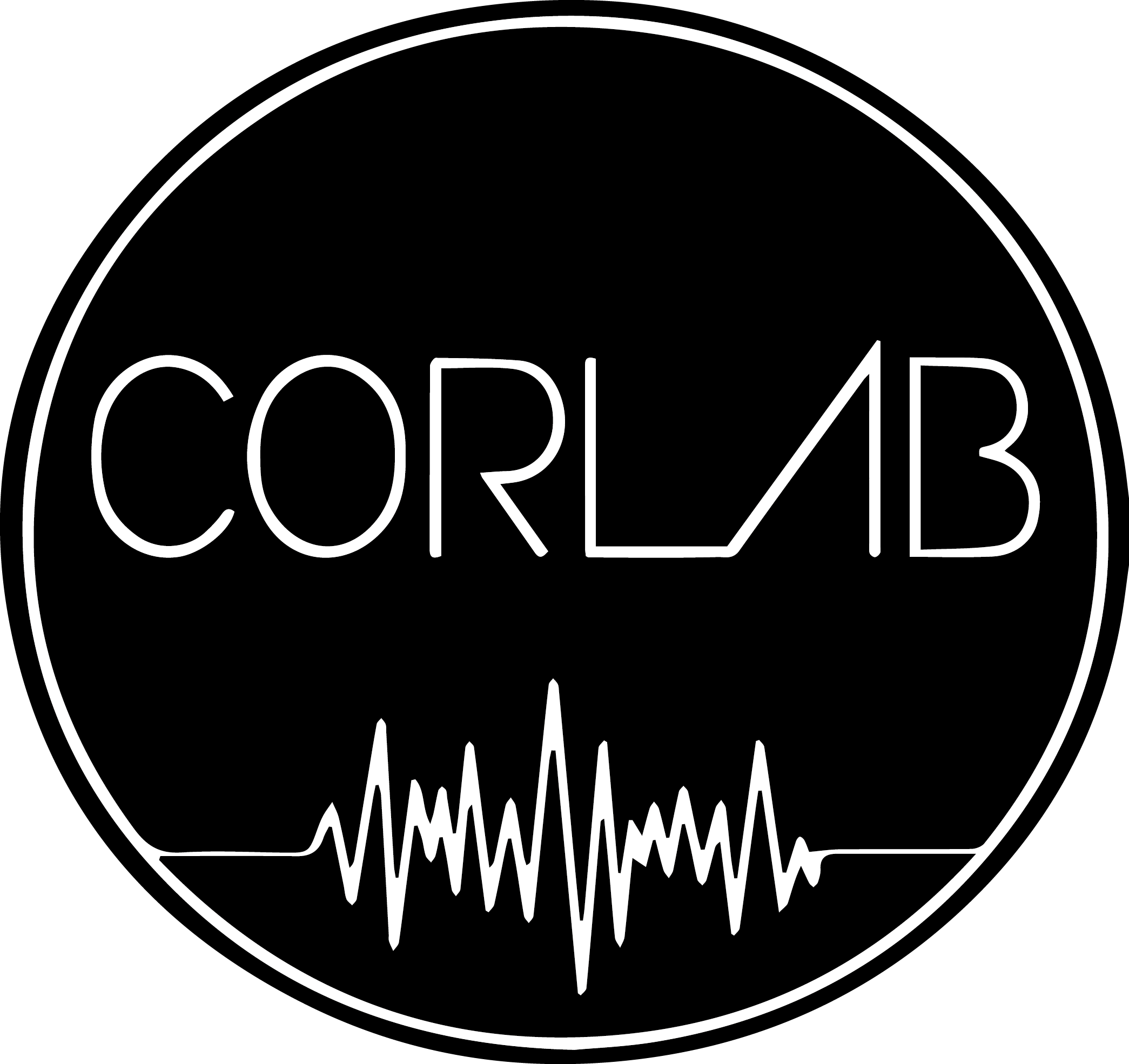MÉMOIRES DE VI(LL)ES
Le Conquet - Radio U
« Mémoires de vi(ll)es » est un projet de collectages radiophonique porté par l’association Petites Cités de Caractère® de Bretagne et la Coordination des Radios Locales et Associatives de Bretagne (CORLAB).
Cette seconde saison s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet « L’Été culturel » de la DRAC Bretagne, visant à proposer des animations durant la période estivale aux publics qui ne partent pas en vacances.
Photos : Sarah Chajari – L’Atelier du Canal
LES HABITANT·ES

Hubert Michéa

Léonie Ferrelloc

Monique Renault

Pierre Floch

Simone Salaün
LA RADIO

Radio U
Pierre-Louis Leseul
Rencontrer les habitants, en particulier nos aînés, pour recueillir leurs paroles, préserver leurs mémoires et éclairer l’histoire d’une ville ou d’une Petite Cité de Caractère®, représente un défi stimulant. Mais c’est également l’une des missions fondamentales de nos radios associatives, comme en témoigne l’engagement de Radio U. Pour ma part, ce projet m’a permis d’apprendre énormément au contact des habitants sur l’histoire du Conquet. Une histoire singulière qui, pourtant, résonne avec celle de nombreuses villes et villages de la côte finistérienne. J’ai eu le privilège d’échanger avec les résidents de l’EHPAD Le Streat Hir, mais aussi avec Hubert Michéa, une figure emblématique conquétoise, et Annaïg Huelvan, adjointe à la culture, qui a enrichi nos entretiens par ses souvenirs et sa perspective personnelle. Ces moments d’échange ont confirmé, s’il en était besoin, que la radio est un outil précieux pour rassembler et mieux partager.
LES ÉPISODES
Pierre Floch, le pêcheur
Pierre est arrivé au Conquet assez jeune et rapidement, il s’est senti happé par la mer et la pêche. Il a commencé à pêcher à l’âge de 17 ans, une voie classique pour les jeunes après l’école. Dans les années 50, la pêche était très différente de celle d’aujourd’hui. Les bateaux étaient petits et à voile, mesurant environ 10 mètres.
Le matériel de pêche se limitait principalement aux casiers, remontés à la main, et les conditions de travail difficiles exigeaient une grande force physique. L’équipage était généralement composé de trois personnes : le patron, un homme au moteur et un autre pour tirer les casiers. Chaque pêcheur avait son coin de pêche, et des conflits pouvaient parfois éclater. L’arrivée du treuil, inventé par Monsieur Florian, a marqué une évolution significative, facilitant la remontée des casiers et épargnant des efforts considérables.
Après son service militaire, Pierre a embarqué sur des bateaux plus grands, de 15 à 16 mètres qui partaient pêcher la coquille vers Saint-Brieuc et même jusqu’en Angleterre. Les pêcheurs dormaient à bord ou dans les alentours, puis au retour, le samedi après la paye, c’était souvent la fête, avec des moments de convivialité et de beuveries dans les nombreux bistrots.
Le commerce
Les habitants du Conquet se souviennent d’une ville autrefois foisonnante de commerces, épiceries et boutiques de matériel de pêche, avec une concentration particulièrement remarquable de bistrots. Selon la légende, plus de 40 bistrots animaient la cité, offrant à chacun un lieu de rencontre et de convivialité. Ces établissements, aujourd’hui transformés, ont laissé des souvenirs impérissables, comme le bistrot de Monique et l’épicerie voisine, réputée pour ses fruits savoureux. On se rappelle aussi la pâtisserie « Le Mars », la librairie de Raymonde « Chez Pic Du » (en haut de la Rue du « casse-cou ») où l’on trouvait surtout des bonbons, un délice pour les enfants.
Parmi les commerces qui ont disparu, un grand nombre vendait du matériel de pêche pour les amateurs qui n’allaient pas à la coopérative. Parmi les lieux marquants, le bistrot de Jacques Pyrénées et « Chez Titine et Germaine », où l’on pouvait jouer aux boules bretonnes, occupent une place spéciale dans le cœur des habitants. Les bistrots étaient bien plus que des débits de boissons ; ils étaient des lieux d’échange et de sociabilité, des endroits où l’on refaisait le monde.
Hubert Michéa, connaisseur de la culture maritime, se remémore l’ambiance de ces établissements et les scènes pittoresques de la vie quotidienne. Son récit de l’altercation avec les pêcheurs sur la cale Saint-Christophe est très amusant. Il raconte comment il s’est retrouvé mêlé à leurs disputes au petit matin et comment il a finalement été invité à boire un verre avec eux ! Les femmes jouaient aussi un rôle crucial dans la communauté, notamment celles de pêcheurs qui venaient récupérer l’argent de leurs maris après la pêche, avant qu’ils ne dépensent tout, dans les nombreux bistrots situés entre la cale Saint-Christophe et le Nerval actuel.
« De l’autre côté de mon bistrot, il y avait l’épicerie. Elle avait toujours de très bons fruits. »
« Il n’y a pas de café, ce n’est pas l’heure. Il n’y a que du blanc à 6h30 du matin ! »
Le Conquet, une ville devenue touristique
Les récits des habitants du Conquet nous transportent à l’époque du camping sauvage au-dessus de la célèbre plage des Blancs-Sablons, marquant les débuts du tourisme. Dès le mois de mai, les touristes brestois (principalement) arrivaient en séjour et Pierre se souvient de l’espièglerie des enfants du coin qui s’amusaient à déplacer les piquets des campeurs.
Monique raconte aussi le passage quotidien de la boulangère, apportant le pain et le lait, et l’absence de service de ramassage des déchets, obligeant les résidents à improviser des solutions rudimentaires. A l’époque, le camping sauvage était une solution économique pour les vacanciers, contrairement aux locations actuelles, perçues comme plus chères et réservées à une population plus aisée. Sur la plage, les cabines de plage étaient peintes en gris et les enfants jouaient à des jeux aujourd’hui oubliés comme le « pique à rom ». C’était le temps des maillots de bain tricotés en laine ! Et pour se balader, les enfants allaient voir les moutons paître sur les dunes.
En ce qui concerne l’évolution urbaine, Le Conquet s’est transformée depuis les années 1970, voyant naître de nombreuses maisons secondaires et locations touristiques, rendant l’installation difficile pour les plus jeunes. Pierre raconte aussi comment les Conquétois ont su s’opposer à des projets d’urbanisation potentiellement destructeurs, comme la construction d’un pont sur l’aber destiné aux voitures, afin de protéger la pêche locale et la beauté naturelle du lieu.
D’autre part, à entendre les participants, la vie au Conquet dans les années 50 était rythmée par les traditions et le partage communautaire. Lors de la Fête-Dieu, tous les habitants, religieux ou non, participaient à la décoration des rues et des maisons avec des fleurs et des draps blancs. Léonie se rappelle que les familles les plus aisées arboraient des broderies et qu’un petit garçon aux cheveux frisés était toujours désigné pour représenter Jésus. Les pardons ainsi que les fêtes maritimes, comme la « Gouel ar mor », attiraient des foules composées de visiteurs extérieurs. Au quotidien, les habitants faisaient des activités avec le patronage (centre de loisirs), allaient au cinéma ou à la salle de bal « Chez Antonio » pour danser. La famille de Pierre, plutôt de gauche, était qualifiée de « pointue » ce qui était mal vu, car Le Conquet était très catholique. Pendant que les gens allaient à la messe, lui allait au port avec des amis : « emprunter » une canote et partir à la rame à la godille ! La belle époque.
« J’ai assez pour vivre avec ce que j’ai. Y en a qui font toujours plus. C’est dans la nature je pense. »
« On allait à la Molène pour acheter des vaches. Il fallait parfois les faire nager jusqu’au bateau. »
Hubert Michéa : les origines du Conquet
Ce premier épisode, à la fois personnel et historique, aborde les origines de la saison d’Hubert et de la ville elle-même. Bâtie en 1810 après avoir été détruite par les Anglais en 1558, sa maison a autrefois servi d’hôtel, géré par Joséphine Floch. Cela montre la résilience des habitants du Conquet, qui ont su reconstruire leur ville face aux invasions, mais également la place des femmes qui pouvait être propriétaires de biens. Avec humour, Hubert évoque aussi la proposition qu’on lui a fait de raser sa maison lors de son achat, et sa volonté de la préserver ! Il met enfin en avant les défis rencontrés pour retracer l’histoire du Conquet, en raison de la destruction d’archives durant la Révolution française, rendant sa recherche aussi passionnante que frustrante.
Hubert Michéa : Le Conquet, carrefour maritime
Ce deuxième épisode met en lumière l’importance cruciale du commerce maritime pour l’économie du Conquet. Hubert décrit comment la position stratégique de la ville en a fait un passage incontournable pour les navires marchands reliant le nord et le sud de l’Europe, permettant de percevoir des taxes sur les navires de passage. Hubert Michéa souligne également le commerce du vin et du sel, piliers de l’économie locale. L’histoire du Conquet fut par ailleurs marquée par les convoitises des rois et des pirates qui guettaient les navires chargés de précieuses marchandises. L’histoire de la fontaine de Kernevez, où les marins se disputaient l’eau douce, montre aussi les tensions entre les différents équipages. Enfin, Hubert borde le déclin du Conquet avec l’essor de l’arsenal de Brest, illustré par le commentaire d’un cousin de Colbert, qui qualifiait au XVIIIe siècle la ville du Conquet de simple « bourg ».
« Il y avait toujours les rangées de filles à marier ou qui voulaient se marier à l’Ermitage. Elles attendaient les promotions de l’école de la Marine. »
Hubert Michéa : L'arrivée du tourisme et les mutations
Ce troisième épisode nous transporte vers une période de transition pour la ville, marquée par l’arrivée du chemin de fer puis du tourisme, modifiant le développement de la pêche, le paysage urbain et les modes de vie. Hubert explique comment l’arrivée du rail, bien qu’ayant pu favoriser le développement économique du Conquet, a paradoxalement contribué au déclin du commerce maritime traditionnel : le transport des marchandises par voie ferrée ayant concurrencé le transport par bateau. Avec le tourisme, de nouvelles constructions ont vu le jour et les bistrots se sont multipliés : on en comptait 17 entre l’église et « Le Narval », où retrouver la convivialité et les coutumes locales.
Hubert Michéa : Le Conquet sous occupation allemande
L’épisode quatre, porte sur la vie au Conquet pendant la Seconde Guerre mondiale. Hubert Michéa raconte des histoires de la Résistance, de la collaboration, des bombardements et du sabordage de la flotte française à Toulon. Il évoque le récit de Pauline Rivoallon, une habitante du Conquet qui tenait un bar face à la mairie actuelle (l’actuel Bar Ar Dagenta) très fréquenté par les soldats allemands et les résistants. Au Conquet, l’occupation allemande a laissé des traces, avec notamment le démontage de la pompe (puits) en pierre devant la maison d’Hubert, pour faciliter le passage de l’artillerie allemande.
Hubert Michéa : L'ADN maritime du Conquet
Ce dernier épisode souligne la persistance de l’identité maritime du Conquet à travers les siècles, malgré les changements et les évolutions. Hubert revient sur l’importance du port et met en avant la figure de Guillaume Le Testu, un cartographe renommé du XVIe siècle, qui a trouvé refuge au Conquet et réalisé des cartes exceptionnelles, dont une représentant le nord de l’Australie, une information rare et précieuse à l’époque. Il s’émerveille aussi de la diffusion des connaissances maritimes et de l’impact de l’imprimerie, qui a permis de partager ces informations à un public qui plus large. La conversation se clôt sur une réflexion autour de la transmission et l’importance de préserver les traces du passé.