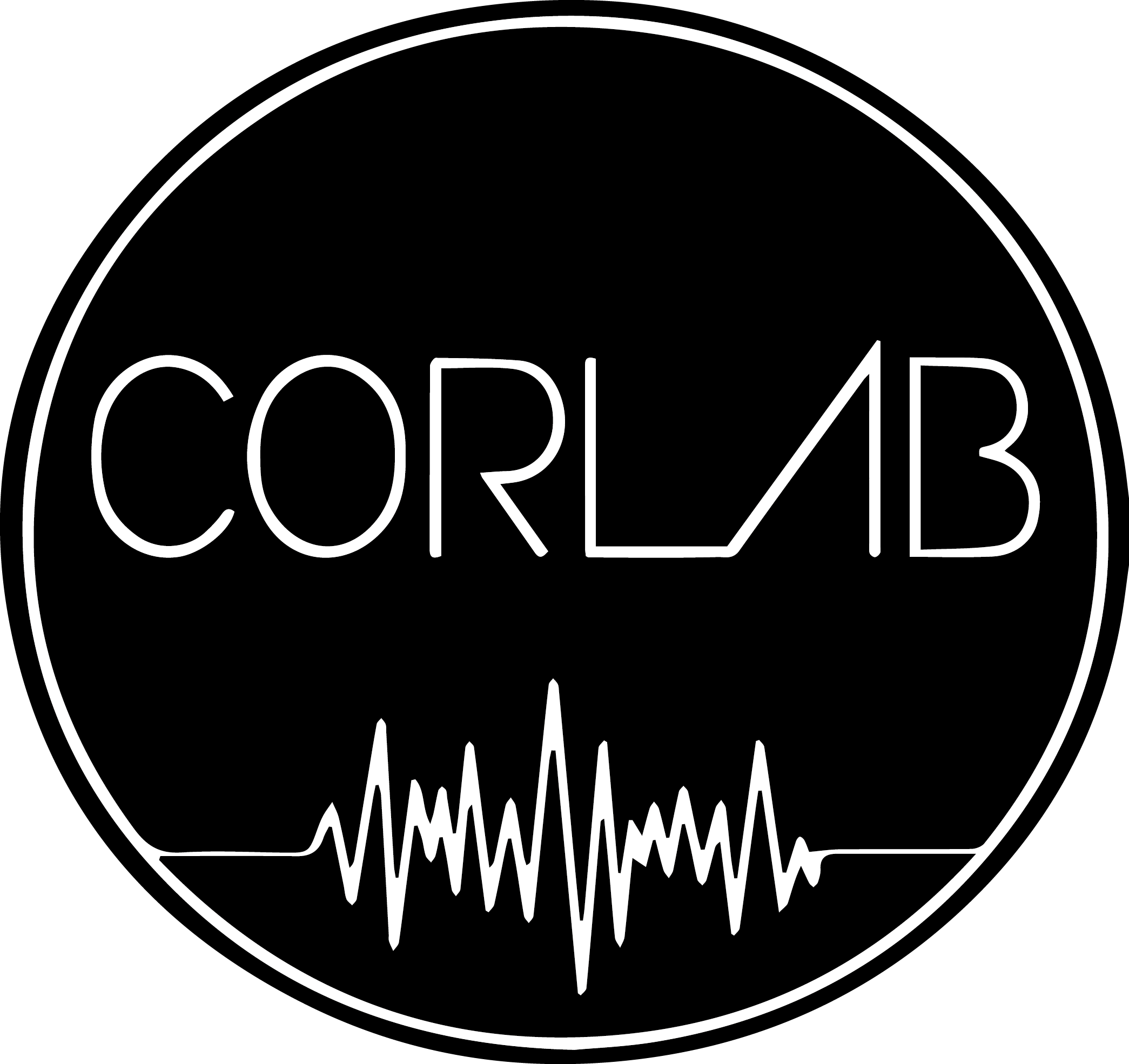MÉMOIRES DE VI(LL)ES
La Roche-Derrien - Radio Kreiz Breizh
« Mémoires de vi(ll)es » est un projet de collectages radiophonique porté par l’association Petites Cités de Caractère® de Bretagne et la Coordination des Radios Locales et Associatives de Bretagne (CORLAB).
Cette seconde saison s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet « L’Été culturel » de la DRAC Bretagne, visant à proposer des animations durant la période estivale aux publics qui ne partent pas en vacances.
Photos : Sarah Chajari – L’Atelier du Canal
LES HABITANT·ES

François Brochen

Janine Laudren

Simone Callac

Paul Loyer

Jeanne Cau

Marie-Annick Savidan
LA RADIO

Radio Kreiz Breizh
Morgan Large
Dans le cadre du projet « Mémoires de vi(ll)es », Radio Kreiz Breizh a eu l’opportunité d’expérimenter le temps long, en se laissant guider d’un habitant ou d’une habitante à un autre, au fil des récits et des souvenirs partagés. À La Roche-Derrien, c’est la mémoire du lin qui a émergé comme un fil conducteur. Cette thématique nous a transportés dans une époque révolue, celle de la première moitié du XXeᵉsiècle, où le lin faisait la renommée de la commune. Les habitants, avec une fierté palpable, se remémorent l’activité de teillage et la réputation du lin local, qui, après avoir été transformé, prenait le chemin des grandes filatures du nord de la France. Ces souvenirs témoignent d’un savoir-faire unique et d’un patrimoine toujours vivant dans la mémoire collective rochoise.
LES ÉPISODES
Marie-Annick Savidan, habitante du centre-ville
C’est avec le sourire que Marie-Annick nous reçoit dans sa maison située en plein cœur de La Roche-Derrien, tandis qu’elle était occupée à monter les bûches vers sa cheminée. Profondément attachée à l’histoire familiale et ses racines rochoises, elle souligne l’ancien statut de La Roche-Derrien, chef-lieu de canton, avec fierté. Elle nous fait découvrir sa ville à travers un album photo familial : on y voit la rue principale autrefois dépourvue de voitures, la rivière sous la neige et une passerelle aujourd’hui disparue. Passionnée par le passé, elle nous conte l’histoire de la « Maison rouge » de ses beaux-parents, située sur la place du centre, autrefois un musée et dont la façade d’origine à colombage a été révélée à la suite d’une tempête. Marie-Annick incarne l’attachement profond des habitants à la mémoire collective de « La Roche » comme on l’appelle.
« C’est l’histoire de la famille qui m’attache à La Roche-Derrien. »
Janine Laudren, un mini musée du lin
L’industrie toilière a été un pilier économique de la Bretagne du XVIIᵉ au XIXᵉ siècle, notamment grâce au lin cultivé sur les plateaux fertiles du Pays Rochois. Cette région s’est spécialisée dans la culture et le « teillage » du lin (la transformation de la plante en fibre), tandis que des villes comme Quintin prospéraient avec leurs ateliers de tissage. Les parents de Janine, fiers de ce travail ardu, employaient une dizaine de salariés et participaient à l’économie locale. Leur quotidien était marqué par le labeur, le bruit des machines, la poussière et les risques de blessures, mais aussi par une grande satisfaction.
Janine détaille toutes les étapes du travail du lin, qui n’ont plus de secrets pour elle : des semis au rouissage, en passant par la récolte, la confection de gerbes et l’égrenage. En fin de chaîne, les fibres les plus nobles, nommées « filasse » (semblables à une chevelure blonde), étaient destinées aux toiles et linge de lit, tandis que les fibres courtes, de moins bonne qualité, « l’étoupe et la chènevotte » servaient à l’isolation des murs, le chauffage et la litière.
En 2011, Janine a inauguré dans son hangar un petit musée dédié à ce patrimoine, attirant 400 visiteurs la première année. Cette inauguration festive, avec accordéon et crêpes, s’est accompagnée par la présentation d’un film de son petit-fils Théo. Aujourd’hui, le lin textile connaît en Bretagne un renouveau grâce à sa culture peu gourmande en eau et en azote, et la demande croissante des consommateurs de produits respectueux de l’environnement.
« Mes parents adoraient ça. Ils étaient fiers de leur lin. Ça a été une catastrophe quand ça s’est arrêté dans les années 50. »
« Les champs de lin sont comme une mer bleue qui ondule avec le vent. »
Paul Loyer, la dernière ferme
Passionné par son métier, Paul a toujours aimé vivre avec ses animaux, une quarantaine de vaches et des chevaux de labour. Il se souvient des tâches quotidiennes liées à leur alimentation, à l’entretien ou au labourage des champs… Paul évoque également le lin, une culture emblématique de la région qui a progressivement disparu avec l’arrivée des tracteurs et la modernisation des pratiques agricoles.
L’arrivée de la déviation en 1989-1990 marqua aussi un tournant dans son parcours, avec la perte douloureuse de ses meilleures terres. Paul regrette le manque de compensation adéquate à l’époque, soulignant les difficultés auxquelles les agriculteurs ont dû faire face lors des aménagements territoriaux. Figure emblématique du monde agricole local, retraité depuis 2006, il a continué à travailler jusqu’en 2022, maintenant la dernière ferme traditionnelle de La Roche-Derrien. Son récit valorise un métier exigeant aussi en mutation, et un lien profond avec la nature. Aujourd’hui, cette région de la « ceinture dorée » qui s’étend jusqu’à Roscoff est davantage réputée pour ses cultures de légumes.
« J’avais assez à faire à la ferme. Je n’allais pas souvent en ville, c’est un paradis sur terre ici. »
François Brochen, salarié agricole
François Brochen (91 ans), résident de la maison de retraite de La Roche-Derrien, poursuit l’histoire du lin en tant qu’ancien salarié agricole. Il se souvient avec précision des différentes étapes de sa culture, de la période de croissance (une centaine de jours) à l’arrachage des plants (d’abord à la main puis grâce aux machines). Il décrit les champs colorés de bleu et de blanc lors de la floraison, l’étalement du lin sur le sol pour le sécher et enfin la mise en gerbe. L’homme nous parle ensuite du rouissage, un processus essentiel pour séparer la fibre de la tige dans des bassins nommés routoirs qui font aujourd’hui la renommée de la région.
Son témoignage met en lumière l’importance des moulins à lin, autrefois présents sur les ruisseaux pour séparer les fibres, le but étant de ne garder que la précieuse filasse. Enfin, François nous rappelle que la culture du lin a progressivement disparu de la région dans les années 1950, victime de la concurrence et de la baisse des prix. Son témoignage, riche en détails, nous offre un voyage passionnant dans le passé agricole de La Roche-Derrien et nous rappelle l’importance de cette plante dans l’histoire de la commune.
« La bonne filasse, c’était pour faire des tissus, des draps, tout ça. »
« On s’est retrouvés trop loin des filatures. Elles étaient à Lille et compagnie. »
Simone Callac, cultivatrice
Simone Callac (99 ans), la doyenne du projet « Mémoires de vi(ll)es » et résidente à l’EHPAD de La Roche-Derrien, partage ses souvenirs de jeunesse à la ferme familiale. Passionnée par son métier, elle se rappelle toutes les tâches quotidiennes qu’elle exerçait à la ferme, de l’entretien des animaux aux travaux des champs.
Elle était entourée de chevaux, cochons et vaches de plusieurs races : animaux à l’époque, indispensables pour labourer la terre. Simone nous offre ensuite un
aperçu de la culture du lin, activité lucrative réalisée par ses parents agriculteurs. Elle se rappelle les champs bleus de lin en fleur, et décrit l’arrachage à la main, une tâche ardue, mais collective qui rassemblait les paysans du coin.
« Moi, je faisais tout à la ferme. »
« Il y avait des arracheurs de lin. On faisait ça entre copains. »