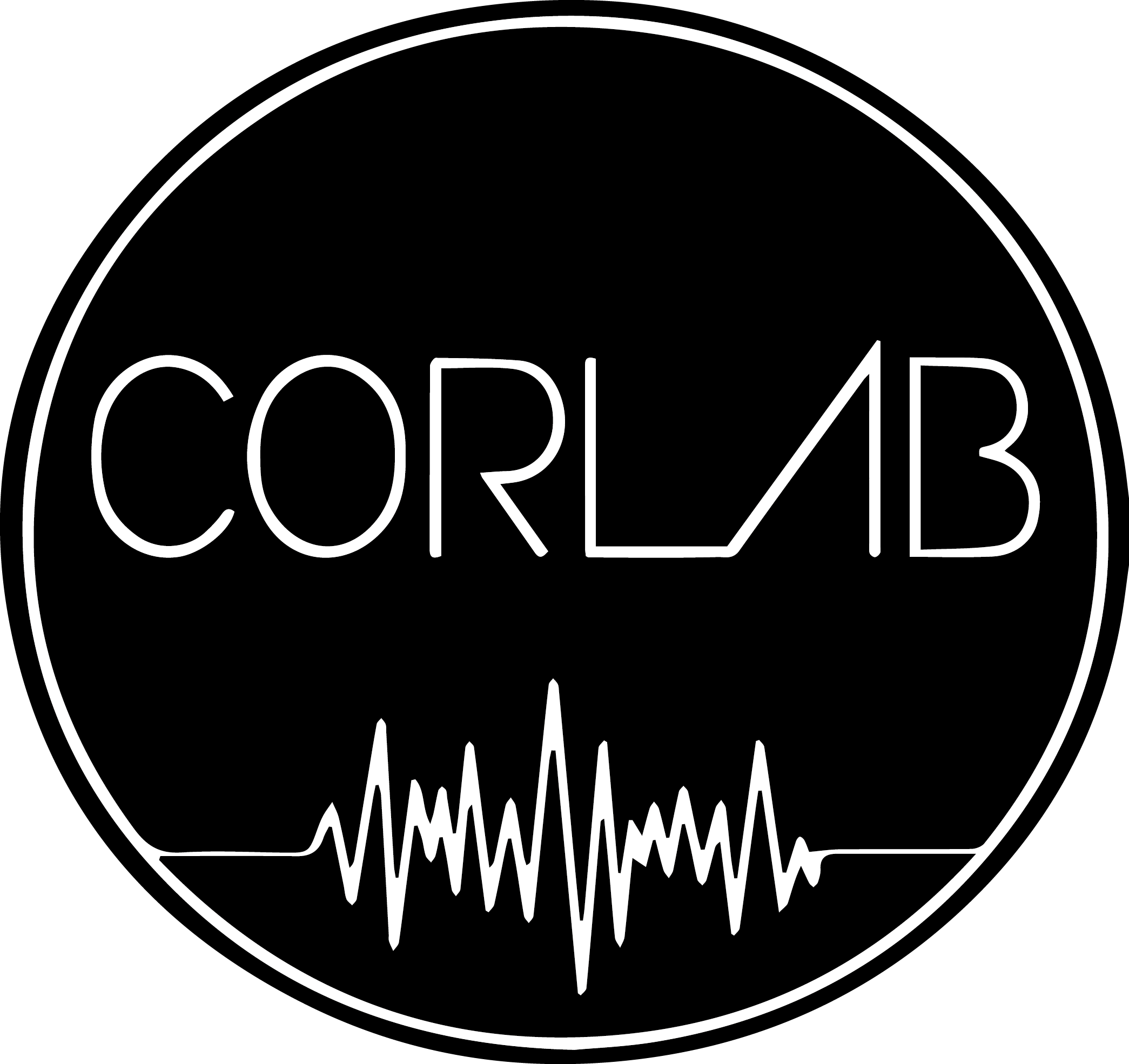MÉMOIRES DE VI(LL)ES
Saint-Aubin-du-Cormier - Canal B
« Mémoires de vi(ll)es » est un projet de collectages radiophonique porté par l’association Petites Cités de Caractère® de Bretagne et la Coordination des Radios Locales et Associatives de Bretagne (CORLAB).
Cette seconde saison s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet « L’Été culturel » de la DRAC Bretagne, visant à proposer des animations durant la période estivale aux publics qui ne partent pas en vacances.
Photos : Sarah Chajari – L’Atelier du Canal
LES HABITANT·ES

Jean-Louis Breton

Anne-Françoise Degroutte

Thérèse Janvier

Jean-Pierre Chevrel

Angèle Galle

Yvon Le Caër

Pierrick Cordonnier

Robert Gayet

Nicolas Lesage

Georges Cupif

Léon Ghérinel

Hélène Morel

Victoire Cupif

Marie-Joseph Heudré

Jeannine Rolandin
LA RADIO

Canal B
Louise Chevalier et Lucie Louâpre
Nous – Lucie et Louise – gardons de très bons souvenirs des ateliers organisés dans les Halles et l’EHPAD de Saint-Aubin-du-Cormier à l’été 2024. La rencontre avec les habitants s’est déroulée dans la joie et les échanges se sont avérés d’une grande richesse patrimoniale et matrimoniale. Au fil des discussions, nourries des suggestions des participants, nous avons eu le sentiment de rencontrer un territoire qui a radicalement évolué après la Seconde Guerre mondiale. Les histoires individuelles que nous ont confiées ces femmes et ces hommes racontent en fait la trajectoire d’une région, entre modernisation et disparition de traditions. Lorsque les ateliers étaient collectifs, ils permettaient une forte émulation ; les enregistrements individuels rendaient quant à eux possible des échanges plus intimistes. Un projet qui confirme l’intérêt de la radio comme outil de collecte d’un patrimoine immatériel.
LES ÉPISODES
L'école
Dans les années 1950, la cité comptait deux écoles composées de classes uniques, l’une privée et l’autre publique, dont Léon se souvient les surnoms comiques donnés aux élèves : les « chouans » et les « crapauds ». En l’absence de mixité, garçons et filles devaient attendre le catéchisme pour se retrouver, ce qui avait lieu le jeudi matin, jour de repos en plus du samedi à partir de 1969. Les rapports étaient tendus entre les deux écoles et Thérèse se rappelle les bagarres qui pouvaient régulièrement éclater sur le chemin du retour (à coup de sabots ou de marrons !). Heureusement, comme le souligne Robert, ancien instituteur, l’instauration de l’école de musique, aida à aplanir les tensions.
L’école était aussi un lieu de discipline stricte. Marie-Agnès décrit les blouses et l’obligation de mettre des patins pour ne pas salir les salles de classe. Anne-Françoise raconte quant à elle ses punitions… pour avoir fait le clown auprès de ses camarades. Du point de vue des enfants de la campagne, comme Georges, l’école était leur premier lieu de sortie et de sociabilisation à partir de 5/6 ans jusqu’au certificat d’études à 14 ans. Il partait de chez lui à pied, traversant champs et chemins pour rejoindre l’école. Quant à Nicole, l’ancienne enseignante, elle se souvient de la proximité entre l’école et les familles, les instituteurs se déplaçant souvent chez les élèves pour discuter avec les parents. Après l’école, les enfants aidaient dans les champs et à la maison ou allaient jouer dans la nature.
C’était comme ça.
« Les enfants de la campagne avaient un petit complexe par rapport à ceux de la ville. »
Le gallo
Le gallo, langue régionale, vecteur d’identité, résonne encore dans les souvenirs des habitants de plus de 60 ans. Yvon se souvient d’une époque où tout le monde parlait gallo, enfants comme parents, mais il n’était pas question de le parler à l’école où seul le français était accepté. A l’âge de 6 ans, lui et ses camarades ont été « rectifiés », tandis que Georges fut réprimandé pour avoir écrit en gallo sur ses cahiers.
Quant à Thérèse, ancienne secrétaire de mairie, elle se rappelle les difficultés de communication avec les cultivateurs qui ne parlaient que gallo. Ces anecdotes mettent en lumière la politique linguistique de l’époque, qui visait à imposer le français comme langue unique et à éradiquer les langues régionales. Au-delà d’une langue, c’est vraiment tout un état d’esprit et une façon d’être qui valorise le monde de la campagne. C’est aussi une langue très imagée qui comporte beaucoup d’expressions métaphoriques et savoureuses que Robert nous déclame : « avoir le lard qui passe par-dessus la couenne » !
Pierrick, passionné par le patrimoine oral, souligne l’importance du gallo comme marqueur identitaire. Il déplore la disparition progressive de cette langue, mais se réjouit de voir des associations et des jeunes s’y intéresser à nouveau. Il existe encore des lieux pour pratiquer cette langue comme La Granjagoul, Maison du Patrimoine oral. Le gallo est un précieux héritage que les habitants s’efforcent de préserver et de transmettre.
« Quand je parle gallo, je m’engueule avec personne parce que c’est comme ça et c’est une façon d’être qui valorise le monde de la campagne. »
Les fêtes et rituels d'antan
Les fêtes et célébrations étaient nombreuses dans le temps. Il y avait d’abord les kermesses organisées par l’école publique et où les enfants défilaient dans la rue. Les animaux étaient au centre des activités, entre courses d’ânes et de cochons, il y avait même des animaux de la ferme à gagner via une roue de la fortune. Imaginez la surprise des enfants lorsqu’ils remportaient un lapin ou une poule ! Cependant, cette tradition a pris fin brutalement à la réception d’une lettre de la SPA pour maltraitance animale, ce qui illustre bien l’évolution des mentalités et des sensibilités au fil du temps.
Le mois de juin était marqué par la Fête-Dieu dont Yvon se rappelle. Bien qu’il n’ait pas fréquenté l’école privée, il était fasciné par la ferveur qui animait cette fête religieuse. Les rues étaient entièrement décorées pour l’occasion : recouvertes de sciure teintée, de marguerites et de marc de café, formant des rosaces et des motifs extraordinaires. Hélène, Marie-Joseph et Victoire participaient activement à la confection des décorations. Sur plusieurs sites étaient construits des « reposoirs », sorte de mini-autels fleuris dédiés à la Vierge Marie, le long desquels s’arrêtait la procession au chant d’hymnes religieux. Ces fêtes ont disparu il y a une cinquantaine d’années, en raison de la circulation automobile, de l’évolution des pratiques religieuses et du développement de nouveaux loisirs, mais les trois amies en garde en souvenir intarissable !
Autre célébration marquante, nous précise Jean-Louis, la Foire commerciale de Noël qui se tenait chaque année le deuxième jeudi de décembre. L’événement attirait des habitants des communes alentours, notamment des ouvriers agricoles qui avaient congé pour l’occasion. Des bals avaient lieu dans les cafés jusqu’au bout de la nuit.
En cas de décès d’un proche, tout un rituel était à respecter. Il fallait veiller les morts chez soi jusqu’aux obsèques et apposer une grande tenture noire sur la maison. Les horloges étaient arrêtées et la radio proscrite. La famille du défunt devait s’habiller en noir avec l’interdiction d’assister à des fêtes ou d’écouter de la musique. Après la cérémonie religieuse, une grande procession s’établissait jusqu’au cimetière. Cela a perduré jusque dans les années 80. La célébration la plus récente est le rassemblement des Saint-Aubin, créé dans les années 90, qui réunit tous les villages du même nom de France, Suisse et Belgique ! Chaque année, durant l’été, l’une des communes organise le rassemblement qui réunit pendant deux jours plusieurs milliers de personnes.
« Les gens passaient un temps fou [à décorer] et c’est vrai que c’était joli. J’ai des souvenirs incroyables de ça. »
La guerre à hauteur d'enfant
Cet épisode nous plonge au cœur d’une période trouble, vécue à hauteur d’enfants, et nous rappelle que derrière les grands événements historiques se cachent des histoires intimes qui façonnent la mémoire, non sans traumatisme. Thérèse avait 8 ans au début de la guerre, elle se rappelle l’aide apportée par son père au Conseiller général Pierre Morel, alors seul élu à attendre l’arrivée des Allemands sur les marches de la mairie. Elle se souvient aussi des résistants et des maquisards du réseau Buckmaster qui avaient des bureaux dans la cour de sa maison, où étaient cachées des armes et des munitions. Les occupants affichaient bien leur présence et n’hésitaient pas à s’imposer chez les gens en pillant leurs denrées alimentaires.
De son côté, Léon surveillait les patrouilles allemandes depuis une fenêtre : sa mission étant de prévenir son grand-père, qui tenait un poste de transmission pour la Résistance, lorsque les soldats approchaient. Jean-Louis raconte à son tour comment son grand-père captait des messages pour la Résistance, et se souvient du parachutage de tracts anglais sur le champ de foire, une mission risquée pour les enfants chargés de les ramasser. La solidarité des habitants se manifestait également dans l’accueil des réfugiés de Saint-Malo. A la Libération, s’en est suivi des célébrations comme la Fête des fleurs.
« Sur le champ de foire, il y en avait plein [de tracts qu’on a ramassé]. On a fini avec des coups de bottes dans le derrière, par les Allemands. »
Ruralité et modernité
Jadis, les habitants nous rapportent que le confort était minime dans les fermes, souvent formées d’une pièce unique où se réunissait famille d’un côté et animaux de l’autre. A l’époque, la taille de l’exploitation se mesurait au nombre de chevaux et non en hectare. L’alimentation était composée de viande, de légumes et de soupe, le lait était très consommé tandis que le cidre coulait à flots, atteignant parfois dix litres par jour ! Le sarrasin était déjà cultivé pour la production de galettes qui étaient cuites tous les vendredis sur une pierre graissée au saindoux.
Le quotidien était rude et le travail omniprésent. Angèle, dont les parents étaient agriculteurs, se souvient que les enfants s’investissaient dès leur plus jeune âge dans les tâches de la ferme, qu’il s’agisse de ramasser les épis de blé, de s’occuper des animaux ou de veiller sur les enfants des voisins. Georges qui fut salarié agricole, explique que l’entraide et le partage entre voisins était cruciaux : chacun se prêtait chevaux et matériel pour les travaux agricoles, et se partageait la viande de porc fraîchement abattue en l’absence de moyens de conservation. Si les maisons étaient éclairées à la lampe à pétrole jusqu’en 1958, les habitants nous relatent l’arrivée de l’électricité qui changea radicalement le quotidien. Ce fut le début des lampes électriques, des congélateurs, de la radio pour s’informer et se divertir, sans oublier les machines à traire et à écraser le blé qui allégèrent considérablement le travail. Jean-Pierre évoque aussi le passage aux grandes exploitations et l’essor du maïs qui redessinèrent le paysage rural.
« Pour le quatre heures, quand il faisait froid, on avait le droit à du cidre réchauffé avec un filet d’alcool dedans. »
Les commerces et services
Si Saint-Aubin-du-Cormier reste une cité commerçante, elle vibrait autrefois d’une activité bouillonnante dont certains métiers ont aujourd’hui disparu. C’est le cas du bourrelier qui s’occupait du matériel pour chevaux et des matelas, mais aussi du chaisier et du charron, spécialiste du bois et du métal. Les foires étaient des événements majeurs, attirant les foules. Pierrick nous informe qu’il existait des marchands de chanson qui vendaient des paroles sur papier, et dont les airs étaient à apprendre sur place, accompagnés par un accordéoniste.
Les métiers étaient peu mécanisés et être boulanger comme Léon signifiait faire du pain toute la nuit à la main. Il fallait aussi assurer la livraison en camionnette dans les campagnes. Les commerçants ne comptaient pas leurs heures. Angèle évoque ses longues journées de travail à l’hôtel-restaurant qui commençaient par les achats des provisions aux Halles, à trois heures du matin. L’absence de chambre froide nécessitait aussi de cuisiner les produits frais du jour, un rythme effréné qui ne laissait aucun répit. Il n’y avait pas non plus de congés maternité pour les femmes qui devaient assurer l’éducation des enfants tout en continuant à travailler.
Le métier de facteur n’a pas échappé aux changements : Jean se remémore ses longues tournées à vélo, parcourant 53 kilomètres par jour. Un véritable lien social qui s’est perdu avec le temps. Quant à la boutique de vêtements de Marie-Agnès et Pierrick, héritée d’une tradition familiale, elle a su traverser les décennies en s’adaptant aux nouvelles tendances de la mode. Marie-Agnès parle de la relation de confiance et de proximité qui existait avec les clients.
« Quinze jours après mes maternités, on a loué un camion pour que je puisse allaiter pendant les repas en salle. »
Le patrimoine architectural et naturel
Dans cet épisode consacré aux patrimoines, Pierrick, passionné d’Histoire, nous transporte sur le champ de bataille de 1488, où les troupes du roi de France et du duc de Bretagne se sont affrontées. Thérèse, ancienne secrétaire de mairie, évoque le monument commémoratif et la petite croix en pierre cachée dans la forêt, symboles d’un passé mouvementé. Elle se souvient d’autre part, avec émotion, de la démolition de l’ancienne église Notre-Dame située sur la place du Carroir, en 1902 par son grand-père. De cet édifice demeure seulement la Tour, qui rivalise de hauteur avec l’actuelle et imposante église Saint-Aubin.
Robert, ancien conseiller municipal et connaisseur d’histoire locale, nous parle avec passion de la réhabilitation des anciennes Halles au beurre en lieu de rencontre avec des cellules commerciales au rez-de-chaussée. Dans les souvenirs de Nicole, les souterrains du château étaient un terrain de jeux très apprécié des enfants pour jouer à cache-cache, malgré les risques d’éboulement de pierres. Une légende parle même d’un souterrain reliant le château de Saint-Aubin à celui de Fougères…
La forêt adjacente, composée notamment de pins, chênes, bouleaux et hêtres, compte cinq menhirs classés. Autrefois attribuées aux paysans par un système d’enchères à la bougie en Mairie, jusque dans les années 60, les parcelles de cette forêt domaniale ont depuis été privatisées, privant les habitants de s’y balader librement.
« On prenait des feuilles de châtaignier et des pics de sapins et on se composait des chapeaux d’indiens, et on arrivait dans le bourg tout en feuilles ! »