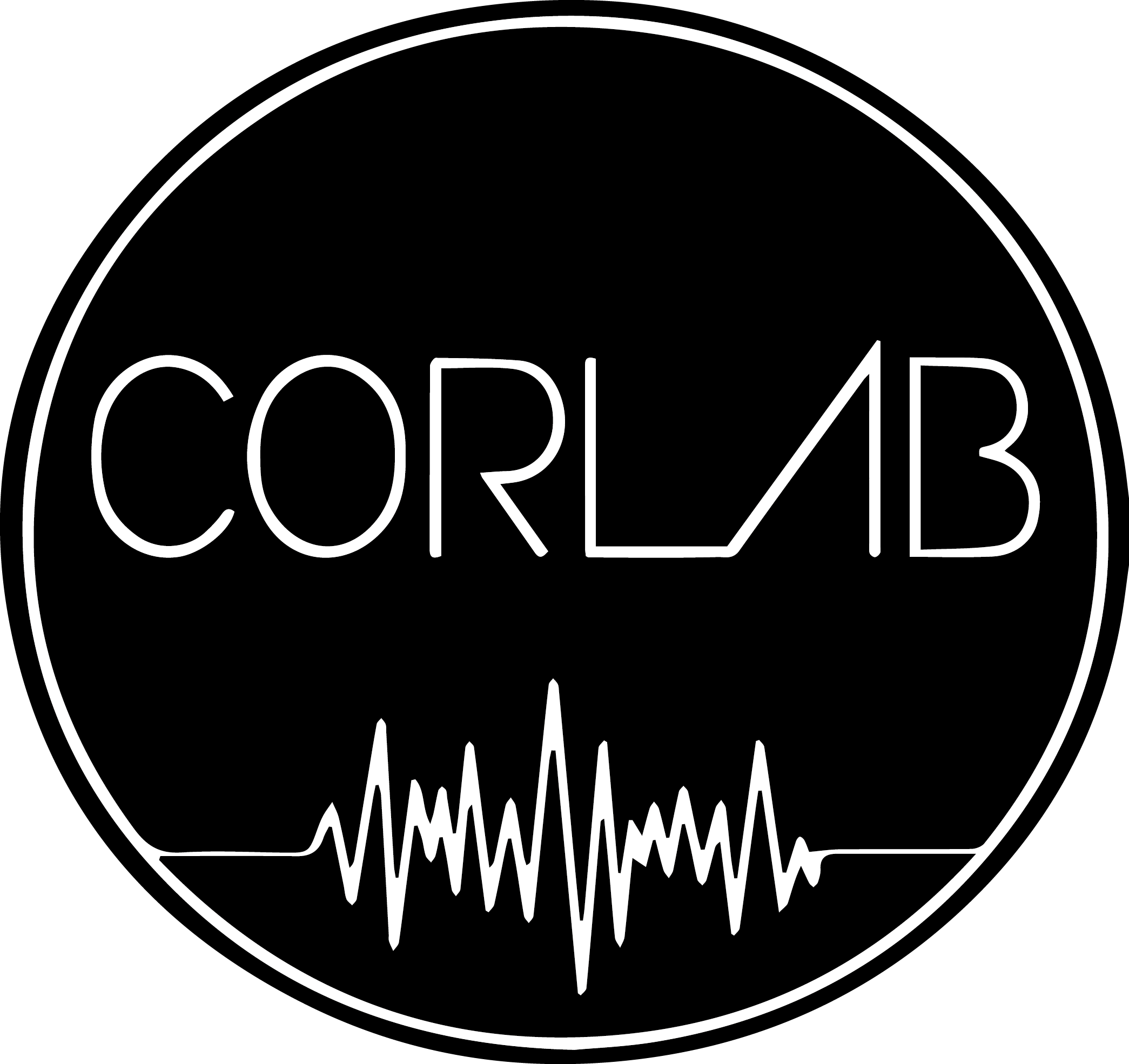MÉMOIRES DE VI(LL)ES
Bazouges-la-Pérouse - Radio Soleil 35
« Mémoires de vi(ll)es » est un projet de collectages radiophonique porté par l’association Petites Cités de Caractère® de Bretagne et la Coordination des Radios Locales et Associatives de Bretagne (CORLAB).
Cette seconde saison s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet « L’Été culturel » de la DRAC Bretagne, visant à proposer des animations durant la période estivale aux publics qui ne partent pas en vacances.
Photos : Sarah Chajari – L’Atelier du Canal
LES HABITANT·ES

Maurice Doré

Marie-Thérèse Greslé

Roger Sachet

Marcel Fleury

Marie Hervé

Jean Touffet

Pierre Goron

Albert Prioul

Jean Tumoine
LA RADIO

Radio Soleil 35
Frédéric Guillet et Corentin Lecointre
Ce projet a été une aventure captivante et pleine de sens pour Radio Soleil 35 étant donné notre implication sur le territoire et notamment à Bazouges-la-Pérouse. En collectant les témoignages à travers la voix de nos aînés, nous continuons à préserver et à partager des récits précieux sur l’histoire et la richesse de la culture locale. Ces histoires recueillies offrent à nos auditeurs et aux habitants du territoire, un aperçu authentique du passé de la ville.
LES ÉPISODES
Marie Hervé et Marie-Thérèse Greslé, une jeunesse entre amies
Les deux femmes nous racontent la vie à Bazouges-la-Pérouse dans les années 50, marquée par une grande solidarité et un profond sens communautaire. L’agriculture était le cœur de la vie et les travaux agricoles, comme la fenaison, la récolte du blé ou la fabrication du cidre, étaient réalisés collectivement. Les fêtes, telles que les communions, étaient des événements festifs où les voisins s’entraidaient pour les préparatifs, la décoration et la cuisine, ce qui renforçait les liens sociaux.
À l’école Sainte-Anne, Marie et Marie-Thérèse suivaient les cours du lundi au samedi, avec une pause le jeudi. Le déjeuner était préparé par le directeur et son épouse dévouée et il se prenait dans la chapelle avec la Sœur Sélestina. Après le certificat d’études, les filles poursuivaient leur éducation au centre d’enseignement féminin, pour acquérir les compétences nécessaires à la vie de femme au foyer : la couture, la cuisine et le ménage étaient au cœur de l’apprentissage.
Evidemment, l’arrivée de l’eau courante et de l’électricité a radicalement changé le quotidien, tandis que la télévision, d’abord un luxe chez quelques voisins privilégiés, s’est démocratisée. Les familles se réunissaient pour regarder les feuilletons et les émissions populaires de l’époque. Pour une grande partie des Bazougeais, les dimanches étaient rythmés par la messe (il y en avait trois, à 6h30, 8h30 et 11h), d’ailleurs l’église était pleine ! Après la cérémonie, les adultes écoutaient les nouvelles du garde champêtre et se réunissaient au bistrot, tandis que les enfants en profitaient pour déguster des pâtisseries chez Monsieur et Madame Travers. Les distractions étaient moins nombreuses qu’aujourd’hui, mais les deux amies aimaient faire leurs emplettes en ville, danser aux bals le dimanche, aller au cinéma, à l’école des garçons et aux fêtes organisées par le Père Laon. La belle époque, comme elles disent !
« Ton père emmenait le transistor dans l’étable pour que les vaches entendent la musique. Le dimanche matin à fond, quand il balayait la cour (…). Il y avait déjà de l’ambiance ! »
« C’était la belle époque. C’était naturel, il y avait aucun lien de méchanceté, c’était zen. »
Pierre Goron, le pommé
Après avoir évoqué l’école, Pierre s’illustre comme un fervent ambassadeur du patrimoine culinaire de Bazouges et plus spécifiquement du pommé. Cette spécialité remonte à l’époque de la guerre et porte le surnom de « beurre du pauvre » nous dit-il. Les femmes vendaient du beurre pour subvenir aux besoins de la famille, tandis qu’elles utilisaient les pommes pour faire du pommé. Relancée dans les années 70 par Marcel Fleury (voir en p.24) alors président du Comité des fêtes, le pommé est mis à l’honneur chaque troisième week-end d’octobre par la Confrérie du Pommé, qui organise tous les ans une grande fête.
Pierre en décrit avec enthousiasme le processus de fabrication, entièrement réalisé par des bénévoles depuis la cueillette des pommes jusqu’à la mise en pot, en passant par les longues heures de remuage ou « ramaougerie ». Vous connaissez ? Pierre est aussi très fier de mettre en avant les débouchés du pommé qui s’exporte jusqu’à Paris dans les crêperies ! Aujourd’hui parée des couleurs rouge et verte du pommier, la Confrérie reste soucieuse de transmettre cet héritage aux générations futures. Pierre exprime d’ailleurs ses préoccupations quant au manque de relève et espère que de nouveaux bénévoles rejoindront la Confrérie pour préserver cette tradition gourmande. Appel à volontaires, jeunes ou moins jeunes !
« La tradition, c’est de mettre une pièce de cuivre au fond de la pelle [le chaudron] pour empêcher le pommé de coller. »
Albert Prioul, la vie rurale
Albert nous décrit sa ferme d’autrefois comme un véritable microcosme d’autosuffisance, avec des vaches, des cochons, des poulains et des volailles en liberté. Il cultivait des légumes pour nourrir sa famille et ses animaux, et produisait ses propres pâtés, boudins et pains. Une alimentation saine et locale, en somme ! Les pommiers abondaient et chaque famille fabriquait son cidre, un breuvage quotidien bu directement « au cul de la tonn » ! En 1952, l’arrivée du tracteur a allégé le labeur des champs, tandis que l’arrivée du frigidaire a révolutionné les intérieurs. A l’époque, la religion était très présente : les enfants allaient au catéchisme le jeudi, car il n’y avait pas école, et à la messe, vêtus de leurs habits du dimanche.
Albert se remémore aussi les souvenirs de la guerre qui s’est déclarée durant son adolescence, marquée par l’arrivée des soldats allemands, les réquisitions de nourriture et le passage traumatisant des chars et avions qui mitraillaient. Le château de la Ballue a d’ailleurs joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale, servant de refuge pour des jeunes filles juives et catholiques puis pour le collège Moka de Saint-Malo. Restauré à partir de 1973 par Madame Claude Arthaud, le monument historique et ses jardins embellis constituent aujourd’hui une motivation de visite pour les Bazougeais et les excursionnistes.
« L’arrivée des américains a été une fête, ils étaient les sauveurs ! Ils nous donnaient des cigarettes et des chewing-gums. »
« C’était comme ça, cela aurait été mal vu de ne pas aller à la messe. »
Roger Sachet, l'agriculteur
La vie à Bazouges était animée par des fêtes mémorables que Roger a contribué à façonner. En 1973, il a redonné vie à la Fête des moissons en clôturant les travaux des champs par une soirée dansante et un grand repas composé de choucroute, de rôtis et de coqs au vin préparés pour 900 couverts. Rien que ça ! Toujours ingénieux, Roger a aussi avancé la Fête du pommé qui avait traditionnellement lieu en octobre, au mois d’août, en utilisant des pommes précoces. La fête était alors organisée au parc de Bellevue, sous les sapins. Pendant douze ans, la Fête de la choucroute a également vu Roger et ses amis préparer plus de mille couverts par édition, dont l’argent était reversé aux écoles privées du territoire. Il nous raconte avoir eu l’honneur, un jour, d’accueillir en personne le ministre de l’Agriculture de l’époque ! Ses histoires sont sans fin tant il se souvient de chaque détail.
« Malgré les tuiles qui nous arrivaient dans la vie, ces fêtes nous remettaient dedans ! »
« On passait toute la semaine avec des copains à préparer, c’était affolant. »
Jean Tumoine, l'animation locale
Jean a grandi dans un bourg animé, où les commerces florissaient : 23 cafés, 6 charcuteries, 3 boulangeries… Le marché était un rendez-vous incontournable qui attirait une foule immense chaque jeudi et dimanche. Entre 1905 et 1937, le Tramway d’Ille-et-Vilaine (TIV) reliait la commune à Rennes et Jean se rappelle les voyages mensuels qu’il faisait avec sa mère pour acheter du tabac et faire des emplettes dans les magasins modernes comme les Nouvelles Galeries (aujourd’hui Galeries Lafayette) et au Prix Unique (actuel Monoprix). Sous sa présidence au Comité des fêtes, Bazouges a vibré au rythme de grands événements : galas de catch, fêtes des fleurs, cercles celtiques… Jean fut d’ailleurs un danseur émérite au sein du premier cercle celtique de Haute Bretagne, performant lors des fêtes du patronage et même au championnat du monde au Pays de Galles, un concours qu’il évoque avec fierté ! Jean a vu sa ville natale se transformer au fil des décennies mais il est heureux de voir qu’elle est encore un centre d’emploi, de services et de commerces.
« On a fait un gala de catch dans la salle des fêtes (…) avec des vedettes de l’époque. »
« Énormément de préparation toute l’année. (…) ce sont les personnes de Bazouges qui avaient confectionné les costumes et tout. »
Jean Touffet, la forêt
Dans cet épisode, Jean nous transporte dans son enfance à la campagne, où il décrit avec précision les paysages d’autrefois, marqués par les routes empierrées, les talus boisés et les chemins creux. Il retrace le quotidien des habitants en évoquant les travaux agricoles, l’élevage, les métiers de l’artisanat et une vie sociale simple, mais riche en convivialité. Son récit offre un précieux aperçu de la vie rurale d’antan, où l’entraide et la solidarité étaient essentielles. Il nous rappelle également le travail difficile des enfants placés dans les fermes, contraints de travailler dur en dehors des heures de classe, et la séparation entre ceux qui fréquentaient l’école publique et l’école privée.
Non épargné par la guerre, Jean se souvient de la peur et du chaos de l’exode, des routes encombrées et des bombardements qui ont fait de nombreuses victimes, alors que son père avait été mobilisé en 1939 comme chauffeur au ministère de l’Agriculture. Sur une note plus joyeuse, Jean partage les souvenirs des fêtes de village, rythmés par l’accordéon et les danses dans la paille.
« A la maison forestière avec ma mère, on avait accueilli un couple de Parisiens qui avaient une voiture. Ils nous ont proposé de nous emmener avec eux et heureusement, parce qu’il y a eu un bombardement 24h après. »
Marcel Fleury, le randonneur (et son ami Jean Touffet)
Amis de longue date, Marcel et Jean se rappellent leur jeunesse, à commencer par une mémorable escapade à vélo à Port-Mer, ainsi que leurs jeux en forêt. Jean, dont le père était garde-forestier, nous transporte à l’époque fascinante des sabotiers du XIXe siècle, qui étaient près de 400 habitants à vivre au cœur des bois. Ces artisans itinérants, organisés en clans, déplaçaient leurs « loges » en chaume tous les deux à trois ans pour exploiter de nouvelles parcelles. Ils participaient à une véritable micro-économie forestière qui s’éteindra vers 1940.
Marcel, quant à lui, se souvient de son engagement dans la vie locale, comme « papa » de la célèbre Rando du 1er mai. Il évoque également son implication dans le Syndicat d’initiative et la mise en place d’un village de vacances, visant à développer le tourisme rural. La conversation se poursuit sur les traditions locales, notamment la fabrication du pommé, et se termine par des souvenirs de l’étang de la forêt, lieu de baignade et de promenades, marqué à jamais par quelques tragiques décès.
« Ça nous a donné des idées pour valoriser Bazouges (…). On couvrait en gros tous les lieux touristiques intéressants à visiter. »
Maurice Doré et Daniel Duval, les commerces et cafés
Les deux compères retracent avec nostalgie l’effervescence commerciale de la cité dans les années 50-60. Ils se remémorent la multitude de commerces de proximité qui animaient la vie locale, tenus par des habitants passionnés. On comptait alors 13 débits de boissons, trois boulangeries (dont celle des parents de Daniel), sept boucher-charcutiers (Lemétayer, Roblot, Lemarié, Lenoir, Vallet, Brard…), la pâtisserie du couple Travers, des épiceries, des couturières, des tailleurs (Monsieur Aubrée, Monsieur Pinel…), une mercerie et bien d’autres encore. Il régnait dans les cafés une ambiance chaleureuse, où les clients avaient leurs places attitrées et partageaient des verres d’eau-de-vie après la messe du dimanche. Les élections étaient aussi l’occasion de débats animés, Daniel en témoigne ! A cette époque, la vie était rythmée par les fêtes religieuses comme la Fête-Dieu à la Pentecôte. Tous les habitants, religieux ou non, participaient à la construction de reposoirs, des autels richement décorés dans chaque quartier. Les allées étaient fleuries et pavées de sciure colorée, tandis qu’on décorait les maisons avec des branches de bouleau. Maurice se souvient avoir ramassé des camélias au manoir de Castel Marie.
« Pourquoi mettre des bouleaux sur toutes les maisons ? Je n’en sais rien. Mais ça sentait bon. »
« Tous les commerçants se connaissaient, c’était une belle bande d’amis ! »