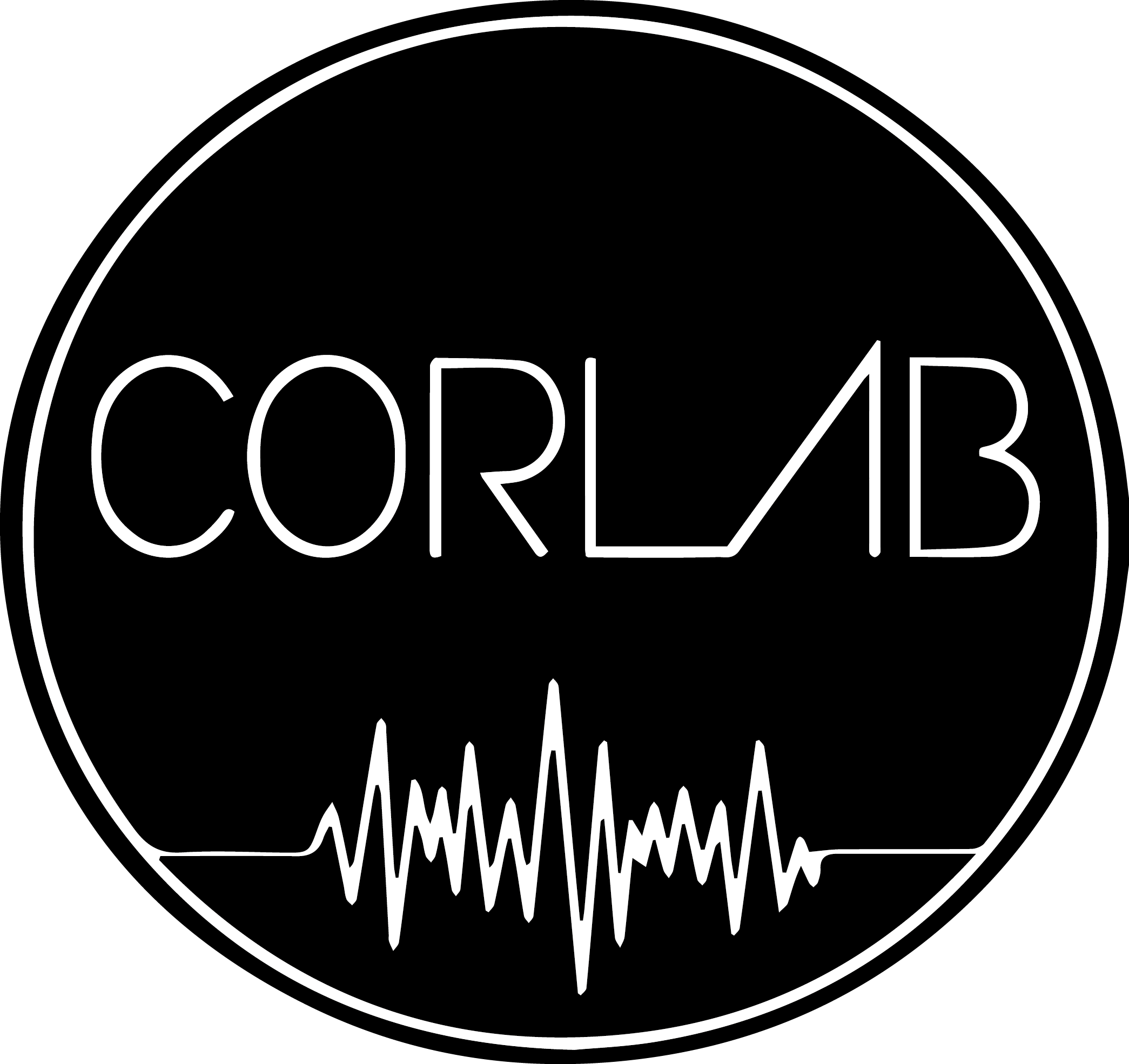Carte d'identité
Fleuve côtier de 26 kilomètres situé dans le Finistère Sud, il prend sa source à Bannalec et traverse les communes de Mellac, Le Trévoux, Riec-sur-Bélon et Baye, avant de rejoindre l’océan Atlantique à Moëlan-sur-Mer.
Par son tracé, il irrigue un territoire marqué à la fois par des paysages agricoles et boisés, par une identité maritime forte, et par une histoire profondément liée à l’ostréiculture.
Ses rives constituent un espace où se croisent activités humaines, patrimoine naturel et mémoire locale, formant un terrain privilégié pour expérimenter une démarche nouvelle : celle d’un atlas socioculturel.
Episode 1 : Identité du territoire
RÉALISATION
Nicolas Milice – Radio BOA
INTERVENANTES
- Nolwenn Le Crann, élue à la culture et à la langue bretonne
à Quimperlé Communauté - Aurélie Benseval, chargée de mission « eau et culture » à l’association Eau et Rivières de Bretagne
Episode 2 : Fables, art et anthropocène
Comment les interprétations, les sensibilités artistiques peuvent se révéler très précieuses sur des problématiques environnementales et en particulier sur le rapprochement, le ré-attachement à nos cours d’eau, à nos fleuves et à nos rivières ?
Reportage sur le Bélon, une des plus belles et poétiques rivières du Finistère sud. Dans le cadre de l’Atlas socioculturel du Bélon, Alexis Fichet a rencontré la rivière et ceux qui vivent autour d’elle pour donner naissance aux « Fables du Belon », recueil de fables pour raconter la rivière dans ses aspects culturels, sociaux, patrimoniaux et environnementaux.
RÉALISATION
Nicolas Milice – Radio BOA
INTERVENANT·ES
- Clémence Hallé, autrice et chercheur à l’Université de Rennes 2 (sa thèse : https://theses.fr/2022UPSLE078)
- Alexis Fichet, auteur, metteur en scène de théâtre, romancier, fabuliste (Les fables du Bélon, éditions Apogée, 2022)
Genèse
L’Atlas du Bélon est né d’une interrogation collective : comment prendre soin ensemble d’un cours d’eau, en allant au-delà des seules approches techniques de gestion de l’eau ? En 2021, la Région Bretagne et l’association Eau et Rivières de Bretagne ont souhaité expérimenter une nouvelle méthode pour valoriser les rivières, en créant des atlas socioculturels. Le Bélon, par la richesse de son patrimoine et le dynamisme de ses acteurs, est apparu comme un terrain idéal pour initier ce type de démarche. La présence du label Pays d’Art et d’Histoire sur le territoire de Quimperlé Communauté, et la tradition de coopération entre associations et institutions locales, ont également constitué des leviers pour lancer rapidement l’expérimentation.
L’idée était simple, mais ambitieuse : rassembler habitants, usagers, associations, artistes et experts pour explorer ensemble les multiples facettes d’une rivière, non pas seulement comme un milieu à protéger, mais comme un être de culture, de mémoire et d’imaginaire. Le projet a été confié à la coopérative d’urbanisme culturel Cuesta, qui a accompagné la démarche durant neuf mois. Ce temps relativement court a pourtant permis de mobiliser une communauté d’acteurs, de mutualiser des connaissances foisonnantes et de faire émerger des outils concrets pour prolonger le travail : notamment un site internet collaboratif, belon.atlas-rivieres.bzh, pensé dès l’origine comme un prototype évolutif.
Objectifs et démarche
L’ambition de l’Atlas du Bélon était d’élargir la question de la préservation des rivières à une dimension socio-culturelle, afin de démocratiser les savoirs, de mieux comprendre l’attachement des habitants à leur environnement, mais aussi d’expliquer les sentiments parfois contrastés, voire de dépossession, que certains exprimaient à propos du fleuve. L’approche adoptée a consisté à mélanger les regards et les pratiques pour dresser un portrait pluriel du Bélon, en donnant toute sa place à la parole des habitants et à l’expression sensible.
Plusieurs types de rencontres ont rythmé la démarche. Les causeries, moments conviviaux où chacun était invité à raconter ses souvenirs et ses expériences du Bélon, ont permis de récolter de nombreux témoignages, mais aussi d’ouvrir des discussions sur l’histoire passée, les usages présents et les possibles futurs de la rivière. Les traversées ont offert l’occasion de parcourir collectivement le cours d’eau, de la ria jusqu’à la source, à pied, à vélo ou en paddle, en français comme en breton. Ces explorations partagées ont permis de redécouvrir des lieux parfois oubliés, comme le fameux aqueduc du Bélon, et d’entrer dans le monde fascinant de l’ostréiculture, activité emblématique du territoire. Enfin, les cartoparties ont complété cette approche en invitant les participants à arpenter le territoire avec une carte à la main, afin de signaler les éléments remarquables, les sites chers à chacun, ou encore les points de mémoire collective qui méritaient d’être transmis.
Aux côtés de Cuesta, plusieurs artistes ont contribué à enrichir l’expérience. L’auteur Alexis Fichet a imaginé neuf fables du Bélon, autant de récits qui donnent voix aux controverses et aux visions multiples du fleuve. Le photographe Sylvain Gouraud a proposé une série de six vues, jouant sur la face visible et invisible de la rivière, invitant à la regarder autrement. La plasticienne Alice Queva a conçu une carte des imachimères, véritable plongée dans l’imaginaire du fleuve. Enfin, deux films, Au Cœur du Bélon et Plouf, réalisés par Erwan Babin et Florian Stéphant, sont venus prolonger le travail d’exploration par l’image et donner une portée encore plus large à cette démarche collective.



Résultats et impacts
Au fil des mois, l’Atlas du Bélon s’est imposé comme un catalyseur de dynamiques locales. Il a mobilisé un réseau varié d’acteurs – habitants, associations de protection de la nature, office de tourisme, établissements scolaires – et permis de tisser de nouvelles coopérations autour du fleuve. Les causeries et traversées ont été l’occasion de rapprocher des générations différentes, de recueillir des récits de vie et d’ouvrir des discussions franches sur les enjeux environnementaux, culturels et économiques. Pour beaucoup, ces moments ont été une redécouverte, parfois même une révélation : certains habitants ont pris conscience de la richesse de leur rivière, d’autres ont retrouvé une fierté à la partager, d’autres encore ont découvert des éléments ignorés jusque-là, comme des vestiges patrimoniaux ou des savoirs ostréicoles méconnus.
Au-delà de cette dimension humaine, l’Atlas a contribué à nourrir des projets structurants pour le territoire. Quimperlé Communauté et le Pays d’Art et d’Histoire ont pu s’appuyer sur cette dynamique pour avancer dans la conception d’un futur Centre d’Interprétation d’Art et du Patrimoine, dont le fil rouge pourrait être l’eau, élément central de l’identité locale. L’office de tourisme, déjà engagé dans la valorisation de l’huître du Bélon, a trouvé dans l’atlas une source d’inspiration pour enrichir ses propositions et impliquer davantage les habitants. Des collégiens de Quimperlé ont réalisé leur propre atlas des cours d’eau, prolongeant la démarche en milieu scolaire et illustrant sa capacité à essaimer.


Pour la Région Bretagne et l’APPCB, ce travail a représenté une manière innovante de rapprocher les habitants des politiques publiques de l’eau et de faire connaître les commissions locales de l’eau. Pour Eau et Rivières de Bretagne, il a constitué une première pierre vers l’élaboration d’états des lieux socio-culturels des bassins versants, susceptibles d’être adossés aux diagnostics environnementaux des SAGE (Schémas d’aménagement et de gestion de l’eau). Ainsi, au-delà de l’expérience locale, le Bélon a servi de laboratoire méthodologique, démontrant l’intérêt d’associer culture, mémoire et environnement dans la gestion des milieux aquatiques.
Mais les impacts de l’Atlas dépassent le cadre institutionnel. En redonnant au Bélon une identité collective, en l’érigeant en objet de récits et d’imaginaires, la démarche a permis d’envisager autrement notre rapport à l’eau. Certains partenaires ont même suggéré, dans le prolongement de réflexions internationales, que les rivières puissent être dotées d’une personnalité juridique, à l’instar de l’Amazonie dans certains pays. Si cette perspective reste encore théorique, elle illustre bien la capacité de l’atlas à nourrir des imaginaires puissants et à interroger les fondements de notre relation aux milieux naturels.



Et demain ?
L’Atlas du Bélon a ouvert une voie nouvelle : celle d’une approche sensible et culturelle des rivières. Demain, il pourra servir de socle pour prolonger la dynamique collective, en inspirant de nouvelles générations d’habitants, d’élèves, d’artistes et d’acteurs publics. Le site collaboratif continuera d’évoluer, nourri par de nouveaux récits et de nouveaux usages. Le projet du Centre d’Interprétation d’Art et du Patrimoine pourra trouver dans l’atlas un fil conducteur pour raconter l’histoire du territoire par le prisme de l’eau.
Et au-delà du Bélon, c’est l’ensemble des rivières bretonnes qui pourraient s’inspirer de cette expérimentation pour bâtir des identités partagées et renforcer la conscience collective face aux défis climatiques et écologiques. En reliant mémoire, culture et environnement, l’atlas n’est pas seulement une photographie d’un territoire à un instant donné : il est une invitation à imaginer ensemble l’avenir.

Les autres atlas
Atlas socioculturel de la Rance par Radio Parole de Vie
Photos : Guillaume Godier - Normandie DronePetit fleuve côtier long de 106 km, La Rance prend sa source à Collinée, dans les...
Atlas socioculturel des marais de Vilaine par Plum’FM
Photos : Guillaume Godier - Normandie DroneLa Vilaine est le dixième fleuve de France. Elle prend sa source dans l’ouest du...
Atlas socioculturel du Léguer par RKB
Photos : Guillaume Godier - Normandie DroneLe Léguer est un fleuve côtier de 59 kilomètres qui draine les plateaux du Trégor intérieur...
Atlas socioculturel de la rade de Lorient par Radio Balises
Photos : Guillaume Godier - Normandie DroneLa rade de Lorient est un vaste estuaire formé par la rencontre de deux fleuves côtiers...
Atlas socioculturel du Lapic par Transistoc’h
Photos : Guillaume Godier - Normandie DroneLe Lapic est un petit cours d’eau côtier du Finistère, au réseau hydrographique de 34...