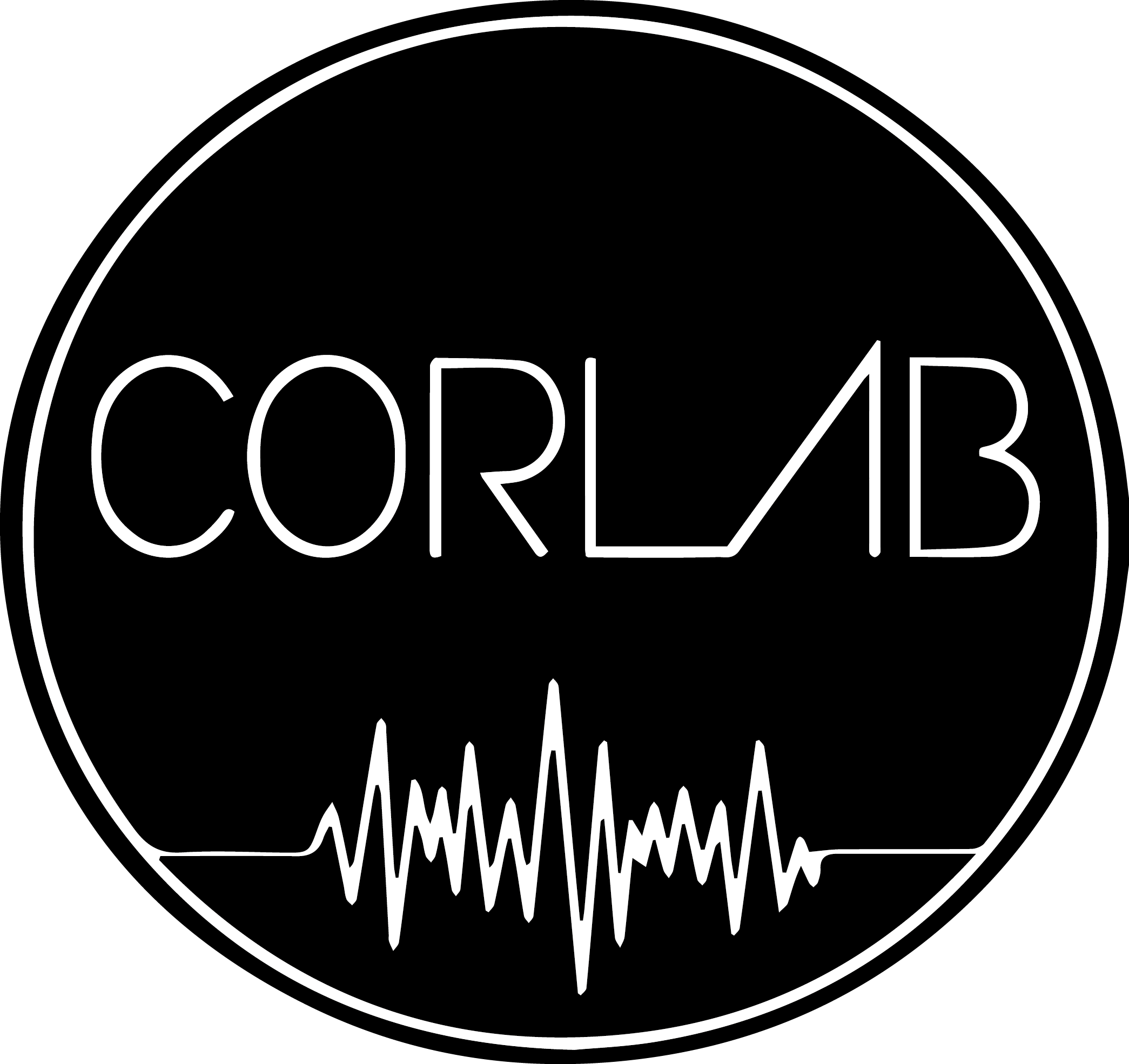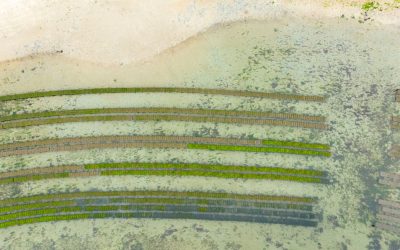Carte d'identité
Le Léguer est un fleuve côtier de 59 kilomètres qui draine les plateaux du Trégor intérieur avant de s’écouler vers le nord. Il se transforme en estuaire et se jette dans la Manche, en baie de Lannion. Son bassin versant, situé à l’ouest des Côtes-d’Armor, couvre environ 540 km² et concerne une trentaine de communes réparties entre trois intercommunalités : Lannion-Trégor Communauté, Guingamp-Paimpol Agglomération et Morlaix Communauté.
Episode 1 : Le mythe du saumon
REPORTAGE
Morgane Large – Radio Kreiz Breizh
ENTRETIEN
Jean-François Jeandet, membre d’Eau et Rivière et vice-président de la Fédération de pêche des côtes d’Armor
Par Nicolas Milice – Radio BOA
Episode 2 : Le rapport terre-mer
Pourquoi, entre les rivières et leurs estuaires, la relation terre-mer est-elle si importante, et doit-elle absolument être restaurée pour le bien de tous ?
Reportage sur le Léguer, cette rivière des côtes d’Armor qui finit son parcours dans la baie de Lannion avec un mytiliculteur qui milite pour la restauration du lien entre paysans de la mer et paysans de la terre.
Recommandations littéraires d’Yves-Marie Paulet
- La forêt amante de la mer d’Hatakeyama Shigeatsu
- Réhabiter le monde d’Agnès Sinaï
- Le passé futur de la Bretagne du XVᵉ au XXIe siècle de Gérard Le Bouëdec et Yves-Marie Paulet
REPORTAGE
Morgane Large – Radio Kreiz Breizh
ENTRETIEN
Yves-Marie Paulet, professeur émérite à l’Université de Bretagne Occidental, Enseignant chercheur en biologie et écologie Marine
Par Nicolas Milice – Radio BOA
Genèse
L’histoire du Léguer est marquée par une mobilisation citoyenne de longue haleine. Dès la fin des années 1970, habitant·es et pêcheurs se mobilisent face aux pollutions agro-industrielles qui dégradent fortement la qualité de l’eau (abattoir Tilly, piscicultures, effluents divers). À l’époque, l’association Eau et Rivières de Bretagne – encore appelée Association de protection et de production du saumon en Bretagne – joue un rôle majeur dans cette lutte. Ces combats donnent naissance à l’Association de sauvegarde de la Vallée du Léguer, puis, en 1990, à l’Association pour la protection et la mise en valeur de la Vallée du Léguer (AVL).
Au fil des années, cette mobilisation se nourrit d’événements marquants. En 1987, les bénévoles s’organisent pour réparer les dégâts causés par l’ouragan qui dévaste la vallée. En 1996, la création du Comité de bassin versant du Léguer renforce encore la structuration des actions locales. Parallèlement, en 1997, la « fête du Léguer » voit le jour, animée par une poignée de bénévoles. Devenue au fil du temps le festival « Léguer en fête », cette manifestation conjugue nature et culture, et contribue à faire du fleuve une véritable colonne vertébrale identitaire reliant les habitant·es de l’amont et de l’aval.
Ces actions convergent vers un résultat majeur : en 2017, le Léguer amont devient la première rivière de Bretagne à obtenir le label « Site Rivières Sauvages », récompensant les efforts collectifs déployés depuis plusieurs décennies. C’est dans ce contexte d’engagement citoyen et d’expérience accumulée qu’a émergé l’idée de créer un atlas socioculturel du Léguer, afin de prolonger et d’élargir la mobilisation en donnant une place centrale aux habitant·es et à leurs attachements.
Objectifs et démarche
L’atlas socioculturel du Léguer repose sur une hypothèse simple : une approche non technique, fondée sur la culture, la mémoire et les attachements, peut favoriser une mobilisation plus large et plus durable en faveur de la rivière. Il est porté par Lannion-Trégor Communauté, en partenariat avec Guingamp-Paimpol Agglomération, Morlaix Communauté et le syndicat de Goas Koll Traou Long.
Le contenu du projet s’est construit dans un esprit de co-élaboration avec les habitant·es. De nombreux dispositifs participatifs ont été mis en place. Des ateliers de cartographie sensible ont permis aux habitant·es de représenter le fleuve à partir de leurs perceptions personnelles. Des ateliers d’écriture partagée et d’« écriture itinérante » ont relié symboliquement les habitant·es de l’amont à ceux de l’aval. Une résidence d’artistes autour des musiques baroques sur la thématique de l’eau a apporté une dimension esthétique originale. Des causeries, conférences, ciné-débats et expositions ont complété cette palette, donnant à voir et à entendre une pluralité de points de vue.
De ces rencontres est né un site internet collaboratif : leguer.atlas-rivieres.bzh. Pensé comme un site évolutif, il propose des boucles pour explorer le Léguer, des points d’intérêts recensés par des participants, des représentations imaginées par des artistes pour proposer une lecture sensible des lieux, des contributions expertes et intimes sur la rivière et ses rives, des informations sur les actualités à venir. Cet outil sert à la fois de vitrine et de mémoire vivante, permettant à chacun de prolonger l’expérience et de partager ses propres apports.
Un autre volet marquant de la démarche concerne la signalétique : pas moins de 75 bornes en bois, équipées de QR codes, ont été installées sur le bassin versant pour redonner un nom aux petits ruisseaux (mais aussi d’éléments de patrimoine lié à l’eau), souvent oubliés. Cette initiative vise à favoriser la réappropriation du réseau hydrographique par les habitant·es, en soulignant que ces petits cours d’eau ne sont pas des fossés, mais contribuent à la santé globale du fleuve.



Résultats et impacts
L’Atlas du Léguer a prolongé et amplifié la dynamique de mobilisation déjà présente sur le territoire. En s’appuyant sur l’élan né du festival « Léguer en fête » et sur les nombreuses actions antérieures, il a permis de rassembler dans un même outil collaboratif les savoirs, les récits et les expériences accumulés. Ce travail a contribué à renforcer le sentiment d’appartenance à la vallée et à consolider le travail d’identité collective autour du fleuve.
Les ateliers et animations ont révélé la force des attachements individuels et collectifs. Les impacts sont également concrets. Le site internet constitue une ressource pérenne, régulièrement nourrie par de nouvelles contributions. Les bornes signalétiques installées dans le paysage rappellent à chacun l’existence des cours d’eau et leur rôle essentiel. Les actions artistiques et culturelles ont, quant à elles, ouvert de nouvelles manières de voir et de raconter le fleuve, élargissant l’horizon des possibles. Enfin, la démarche a créé une dynamique de coopération entre collectivités et associations, consolidant un réseau d’acteur·rices désormais en capacité de porter ensemble les enjeux liés à l’eau et à la biodiversité.





Et demain ?
L’Atlas du Léguer n’est pas un aboutissement, mais une opportunité pour les acteur·rices du bassin versant de poursuivre et faire vivre un travail initié depuis plusieurs années avec les habitant·es et les communes du bassin versant qui ont notamment permis d’obtenir la labellisation « Sites Rivières Sauvages ». Il s’ancre dans une histoire en faisant vivre cette communauté et en l’élargissant. La dynamique en place, les expériences comme le « Léguer en fête », la matière existante sur le bassin versant constituant un atout. Sa force réside dans sa capacité à rester vivant, évolutif, alimenté par de nouvelles initiatives et par l’énergie des habitant·es. Le site internet est pensé pour continuer à recueillir des récits, des images et des témoignages, valoriser de futures actions et réalisations artistiques et annoncer de nouvelles actions. Les artistes et les associations continueront d’apporter leur contribution, nourrissant la mémoire collective et maintenant le fleuve au centre des préoccupations culturelles et environnementales.
Les bornes signalétiques deviendront autant de portes d’entrée vers ces contenus numériques et permettront aux promeneurs de relier l’expérience sensible du terrain à des connaissances plus larges.
Enfin, l’Atlas socioculturel du Léguer poursuit les objectifs de sensibilisation des acteur·rices aux enjeux et politiques de l’eau et de création d’une identité de territoire « Léguer » du Projet de Territoire pour l’Eau du bassin Versant Vallée du Léguer.


Les autres atlas
Hors-séries atlas socioculturel
En complément des six atlas socioculturels documentés dans la collection de podcast Rives et récits, Radio BOA est partie à la rencontre de trois...
Atlas socioculturel de la Rance par Radio Parole de Vie
Photos : Guillaume Godier - Normandie DronePetit fleuve côtier long de 106 km, La Rance prend sa source à Collinée, dans les...
Atlas socioculturel des marais de Vilaine par Plum’FM
Photos : Guillaume Godier - Normandie DroneLa Vilaine est le dixième fleuve de France. Elle prend sa source dans l’ouest du...
Atlas socioculturel de la rade de Lorient par Radio Balises
Photos : Guillaume Godier - Normandie DroneLa rade de Lorient est un vaste estuaire formé par la rencontre de deux fleuves côtiers...
Atlas socioculturel du Lapic par Transistoc’h
Photos : Guillaume Godier - Normandie DroneLe Lapic est un petit cours d’eau côtier du Finistère, au réseau hydrographique de 34...
Atlas socioculturel du Bélon par Radio BOA
Photos : Guillaume Godier - Normandie DroneFleuve côtier de 26 kilomètres situé dans le Finistère Sud, il prend sa source à Bannalec...