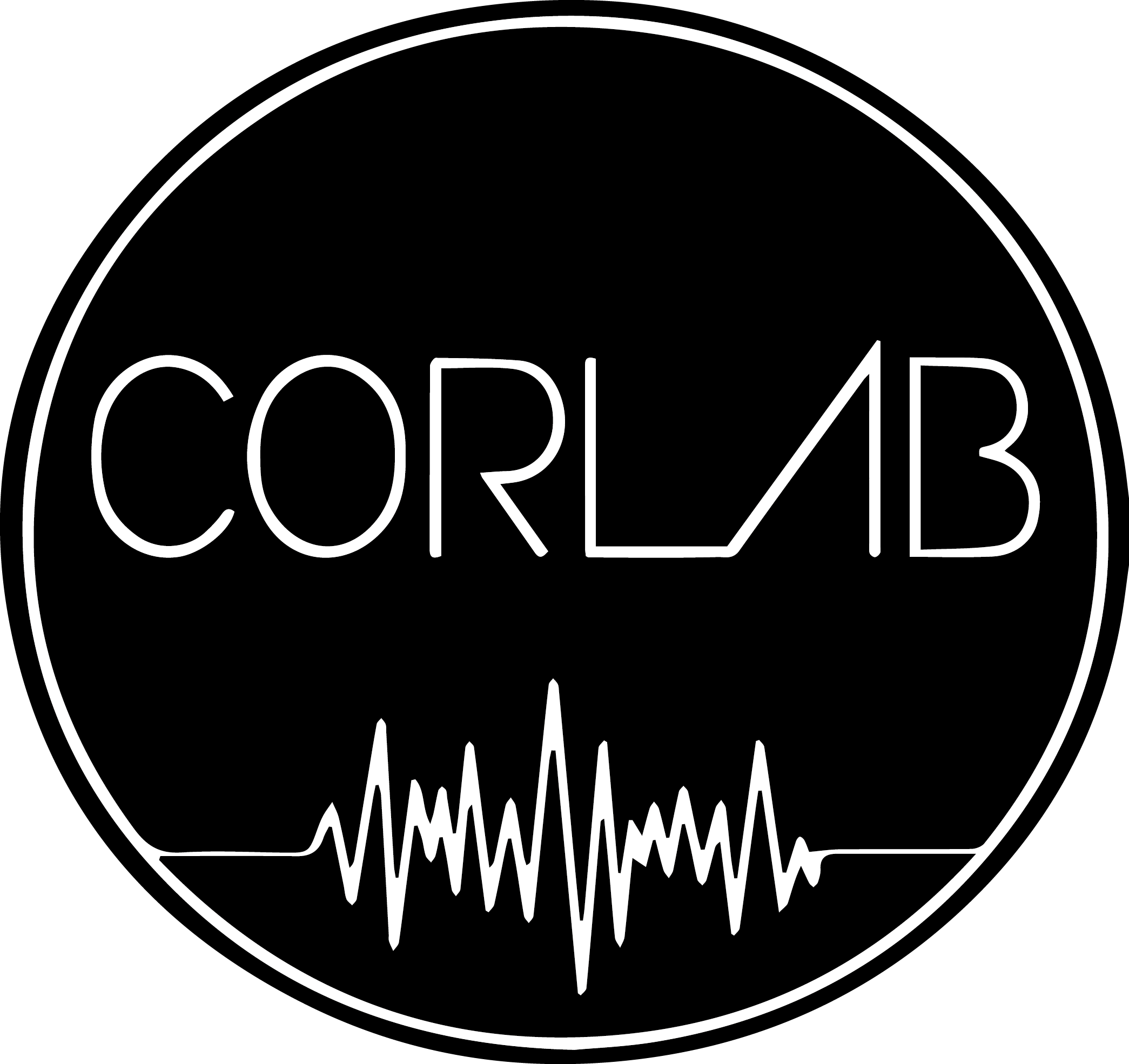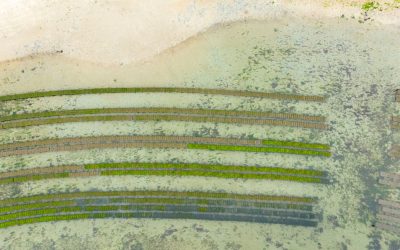Carte d'identité
Le Lapic est un petit cours d’eau côtier du Finistère, au réseau hydrographique de 34 kilomètres, dont près de 13 kilomètres de cours principal. Son bassin versant s’étend sur une surface de 27 km².Il prend sa source à Cast, Quéménéven et Locronan. Il traverse la commune de Plonévez-Porzay et se jette dans la baie de Douarnenez, au niveau de l’anse de Tréfeuntec. Son bassin versant correspond majoritairement à un espace rural à vocation agricole. Autrefois bien identifié par la population locale, le Lapic est aujourd’hui un cours d’eau peu connu, aux accès souvent limités, que beaucoup d’habitant·es n’ont jamais approché.
Episode 1 : L'accès aux berges
C’est par exemple le cas du Lapic, une rivière qui ruisselle de Locronan à la baie de Douarnenez dans le Finistère et qui a beaucoup évoluée au fil du temps. Partons à la rencontre de cette rivière Lapic et de ce besoin d’accès aux berges révélé par l’Atlas socioculturel qui y a été organisé durant l’année 2023.
REPORTAGE
Véronique Museau – Transistoc’h
ENTRETIEN
Gaëlle Vigouroux, vice-présidente de l’EPAB (établissement public d’aménagement de baie de Douarnenez)
Par Nicolas Milice – Radio BOA
Episode 2 : L'évolution du paysage
Remontons à la source du Lapic et son fonds de vallée dans le Menez Hom dans le Finistère. Son paysage a beaucoup évolué à travers le temps. Au fil de la disparition de certaines activités, en particulier agricoles, certaines prairies humides ont été laissées à l’abandon et se sont enfrichées et reboisées naturellement. Mais est-ce bénéfique pour la perception que nous avons de la rivière, ainsi que pour ses qualités hydrauliques et sa biodiversité ?
RÉALISATION
Véronique Museau – Transistoc’h
ENTRETIEN
Simon Dufour, enseignant chercheur à l’Université de Rennes 2, en charge du programme Écofriche
Par Nicolas Milice – Radio BOA
Genèse
Les transformations socio-économiques ont profondément marqué l’histoire du Lapic. La réorganisation du foncier et la fermeture progressive des accès naturels ont provoqué une rupture du lien entre la rivière et les habitant·es. Certains la fréquentaient enfants, mais nombre d’entre eux n’en ont même jamais entendu parler. Pourtant, la mémoire de ses usages anciens, dont ceux liés aux moulins et au chanvre, reste vive chez quelques passionné·es.
Le territoire de la baie de Douarnenez fait partie des 8 baies bretonnes concernées par le plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes. Ici, les cours d’eau sont le plus souvent abordés sous l’angle de la pollution par les nitrates, une lecture qui occulte toute la richesse du cours d’eau et de ses multiples interactions dans la vie des acteurs du territoire. C’est dans ce contexte que l’Établissement Public de Gestion et d’Aménagement de la Baie de Douarnenez (EPAB) s’est lancé dans une démarche d’atlas socio-culturel, avec l’objectif de (re)créer du lien entre les habitant·es, les usager·ères et leur rivière.
Dès les premières étapes, le projet a bénéficié de la mobilisation spontanée de passionnés : le maire de Plonévez-Porzay † 2024, enfant du Lapic, fin connaisseur de son histoire associée à celle de sa commune, un groupe de randonneurs, dont l’un des membres, agriculteur à la retraite, s’est pris de passion pour l’histoire des moulins et du patrimoine riverain du Lapic, ou encore une association locale active du village de Tréfeuntec. Ces acteurs ont constitué le terreau fertile pour l’émergence de l’atlas.
Objectifs et démarche
La démarche a poursuivi un objectif clair : (ré)inventer et (re)créer la relation entre les habitant·es et leur rivière, à travers des outils participatifs et des approches variées. Pour ce faire, plusieurs formes de rencontres et d’animations ont été mises en place.
Les causeries ont constitué le premier temps fort. Réunissant habitant·es et usager·ères autour de la carte du bassin versant du Lapic, elles ont permis à chacun d’annoter ses connaissances, de partager ses souvenirs et de raviver des attachements oubliés. Les traversées (balades in situ) ont donné l’occasion de (re)découvrir le Lapic sur le terrain. La chorale de l’association des randonneurs a mis en valeur par ses voix le Lapic, et chanté «Traon ar Lapic ». L’histoire du maquis de Meilh Quistinic a été racontée sur site, par des locaux l’ayant vécu, enfants. Le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées de Plonévez-Porzay a été expliquée aux habitants. L’EPAB a présenté les travaux de restauration de la continuité écologique du cours d’eau menés pour améliorer la qualité et le fonctionnement des milieux aquatiques. D’autres sorties sur le territoire ont permis d’enrichir les rencontres autour du Lapic, en y associant des approches sensibles : la visite d’une ferme a été associée à un atelier d’écriture avec les enfants et les parents, près du Lapic, dans la prairie. Une balade sur les paysages du Lapic a été organisée en partenariat avec le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement). Les scolaires, avec leurs maîtresses, sont allés découvrir le Lapic au bois du bourg, site sur lequel la mairie élabore un plan de gestion. Ainsi, le cours d’eau, aux multiples facettes, a été abordé et a rapproché les différents acteurs du territoire.
L’équipe du projet de l’EPAB a aussi choisi d’aller à la rencontre des habitant·es « là où ils étaient ». Ainsi, le marché local est devenu, pour un dimanche, un lieu de discussion autour de la rivière. L’association Lin et Chanvre a réuni les habitant·es lors d’une conférence autour du patrimoine chanvrier sur les bords du Lapic, à partir d’un inventaire exceptionnel réalisé grâce au cadastre napoléonien : pas moins de 317 routoirs ou lavoirs à chanvre ont été recensés sur Cast, Locronan, Plonévez-Porzay et Quéménéven.
Le projet a également valorisé les expressions artistiques et sensibles : cartes postales dessinées par les habitant·es, « rivière aux souhaits », ateliers d’expression libre, collecte de témoignages oraux et écrits… Une série de podcasts a été produite en partenariat avec la radio locale Transistoc’h, donnant une voix nouvelle au Lapic et diffusant plus largement les récits collectés. Les parcours mis en forme par l’association « Histoire d’écrire » sont disponibles en podcasts également. Finalement, deux livrets ont été élaborés, permettant de partager cette aventure sur le papier, et de mettre en valeur le lien sensible des habitant·es vis-à-vis du Lapic.



Résultats et impacts
Les résultats de la démarche ont été riches, tant sur le plan humain que culturel. Chaque rencontre, qu’elle ait été collective ou individuelle, a contribué à rapprocher des personnes qui parfois ne se connaissaient pas, à décloisonner des générations, à éveiller des curiosités. Une anecdote illustre parfaitement cet esprit : deux cousines, qui ne se connaissaient pas, se sont découvertes à l’occasion d’une causerie. Pour certains, l’atlas a été une véritable révélation : l’une des participantes a appris, pour la première fois de sa vie, le nom de la rivière qu’elle longeait dans son enfance. Ces redécouvertes ont nourri un imaginaire collectif, où la poésie côtoie la mémoire et où l’attachement au cours d’eau devient fédérateur, indépendamment des convictions ou des usages.
Au fil des traversées, des causeries et des ateliers, les habitant·es ont retrouvé un accès à leur rivière. Mais il ne s’agit pas seulement de marcher sur ses rives : certains ont exprimé leur plaisir à simplement en parler, à l’imaginer, à partager leurs souvenirs. La force de l’atlas a été de multiplier les portes d’entrée : historique, patrimoniale, scientifique, technique, artistique, sensible, sportive, économique. Ce kaléidoscope de regards a permis de renouveler la perception du Lapic et de renforcer l’appropriation collective du cours d’eau.


La presse locale s’est emparée de cette dynamique, notamment à travers une série d’articles de la journaliste Anaëlle Larue dans Le Télégramme, contribuant à élargir encore la visibilité du projet et à sensibiliser un plus large public. Cette mise en lumière médiatique a renforcé le sentiment d’importance au Lapic et a encouragé les habitant·es à s’engager davantage.
Enfin, le projet a démontré l’importance de la co-construction. En adaptant les actions aux propositions des habitant·es, en sollicitant les associations locales, en prenant soin d’impliquer les volontaires dans la préparation des traversées (autorisation de passage, organisation logistique, etc.), l’atlas a réussi à construire un processus véritablement collectif, dans lequel chacun a trouvé sa place et reconnu sa contribution.



Et demain ?
La première étape de l’atlas du Lapic s’est conclue par un évènement festif, « Le Lapic en fête », rassemblant tous ceux qui avaient pris part à l’aventure, qui l’avaient suivie et qui découvraient le projet. Ce rassemblement a permis de valoriser le travail accompli par chacun, de partager de nouvelles connaissances et d’ouvrir vers de nouvelles perspectives à porter. Ainsi, l’histoire du Lapic ne s’arrête pas là. L’atlas a révélé un potentiel d’appropriation et de mobilisation citoyenne considérable, qui ne demande qu’à être prolongé.
Demain, les associations locales pourront continuer à nourrir cette dynamique en s’appuyant sur les savoirs collectés et en développant de nouvelles formes d’expression. Les acteurs institutionnels, de leur côté, pourront intégrer ces dimensions sensibles et culturelles dans la gestion du bassin versant, en complément des approches techniques. Enfin, les habitant·es eux-mêmes ont désormais entre leurs mains un récit commun, qui peut devenir un outil de transmission aux générations futures.
Plus largement, l’expérience du Lapic confirme qu’une petite rivière, parfois invisible, peut redevenir un puissant vecteur d’identité et de lien social. Elle ouvre la voie à de nouvelles expérimentations, où l’eau n’est plus seulement une ressource, mais aussi un bien commun porteur d’histoires, d’émotions et de projets collectifs.

Les autres atlas
Atlas socioculturel de la Rance par Radio Parole de Vie
Photos : Guillaume Godier - Normandie DronePetit fleuve côtier long de 106 km, La Rance prend sa source à Collinée, dans les...
Atlas socioculturel des marais de Vilaine par Plum’FM
Photos : Guillaume Godier - Normandie DroneLa Vilaine est le dixième fleuve de France. Elle prend sa source dans l’ouest du...
Atlas socioculturel du Léguer par RKB
Photos : Guillaume Godier - Normandie DroneLe Léguer est un fleuve côtier de 59 kilomètres qui draine les plateaux du Trégor intérieur...
Atlas socioculturel de la rade de Lorient par Radio Balises
Photos : Guillaume Godier - Normandie DroneLa rade de Lorient est un vaste estuaire formé par la rencontre de deux fleuves côtiers...
Atlas socioculturel du Bélon par Radio BOA
Photos : Guillaume Godier - Normandie DroneFleuve côtier de 26 kilomètres situé dans le Finistère Sud, il prend sa source à Bannalec...